 Voir le reportage
de l'époque sur
Youtube.
Voir le reportage
de l'époque sur
Youtube.[Le 31 octobre 1952] une première expérience
(nom de code « Mike ») a prouvé la justesse de la théorie
de la réaction thermonucléaire : il y a eu fusion
des isotopes d'hydrogène, libérant une incroyable
quantité d'énergie. Le souffle a littéralement
pulvérisé l'île d'Elugelab, dans le Pacifique,
large d'un kilomètre et demi.
 Voir le reportage
de l'époque sur
Youtube.
Voir le reportage
de l'époque sur
Youtube.
On estime que la détonation équivaut
à celle de dix millions de tonnes (ou dix mégatonnes)
de TNT. Elle est donc presque mille fois plus forte que celle
d'Hiroshima. Cependant, le système n'est pas opérationnel
tel quel. Il a fallu, en effet, une machine réfrigérante,
plus grande qu'une maison à un étage et pesant soixante
cinq tonnes, pour conserver l'hydrogène à l'état
liquide avant la détonation. On met donc une nouvelle bombe
plus puissante - et plus perfectionnée - à l'étude.
Le 1er mars 1954, on se sert de l'isotope d'hydrogène sec
appelé deutérure de lithium 6 - ce qui signifie
que le système peut fonctionner sans réfrigération
- pour faire exploser « Bravo », une bombe de quinze mégatonnes, soit une fois
et demie plus puissante que Mike. Pourtant, ce n'est pas la puissance
de cet engin qui compte. Mike était encombrant, difficilement
adaptable à des fins militaires. Bravo est une arme pratique,
qui peut être lâchée d'un avion ou expédiée
par missile.
 Mais, finalement, le plus important c'est
que Bravo va faire comprendre au monde entier le danger des retombées
radioactives et ce non à cause de sa puissance, mais à
cause d'un léger changement météorologique.
Bravo explose à la surface de l'atoll de Bikini, dans les
îles Marshall, pulvérisant des millions de tonnes
de corail qui sont aspirées par l'énorme boule de
feu qui se transforme en un gigantesque nuage blanc. A mesure
que celui-ci grandit, le vent assez violent change de direction
pour souffler de quelques degrés plus à l'est :
le nuage de retombées parcourt rapidement l'océan
Pacifique et, sous l'effet de la pesanteur, les particules de
corail radioactives commencent à redescendre sur une zone
en forme de cigare de onze mille kilomètres carrés.
Le nouveau chemin des retombées passe directement au dessus
d'un certain nombre d'îlots habités des îles
Marshall, dont la population se trouve exposée à
des radiations allant jusqu'à 175 rem.
Mais, finalement, le plus important c'est
que Bravo va faire comprendre au monde entier le danger des retombées
radioactives et ce non à cause de sa puissance, mais à
cause d'un léger changement météorologique.
Bravo explose à la surface de l'atoll de Bikini, dans les
îles Marshall, pulvérisant des millions de tonnes
de corail qui sont aspirées par l'énorme boule de
feu qui se transforme en un gigantesque nuage blanc. A mesure
que celui-ci grandit, le vent assez violent change de direction
pour souffler de quelques degrés plus à l'est :
le nuage de retombées parcourt rapidement l'océan
Pacifique et, sous l'effet de la pesanteur, les particules de
corail radioactives commencent à redescendre sur une zone
en forme de cigare de onze mille kilomètres carrés.
Le nouveau chemin des retombées passe directement au dessus
d'un certain nombre d'îlots habités des îles
Marshall, dont la population se trouve exposée à
des radiations allant jusqu'à 175 rem.
Aussitôt, c'est la panique et l'évacuation. C'est
la première catastrophe officielle concernant les retombées.
La CEA [américain] pense cependant pouvoir maîtriser
ses effets sur le plan politique, car les victimes se trouvent
probablament assez loin des Etats-Unis pour que l'on évite
l'esclandre. Le 12 mars, la CEA publie un communiqué de
presse sur l'explosion de Bravo, mémorable pour son caractère
elliptique, voire délibérément mensonger :
« Au cours d'une expérience atomique de pure
routine [comme si l'on pouvait considérer comme parfaitement
banale la première bombe H d'un format maniable] 236 habitants
ont été évacués des atolls voisins
[...] comme cela avait été prévu, par mesure
de précaution [laissant entendre que la chose avait été
« prévue » avant que le vent ne tourne].
Ces personnes ont été, par inadvertance, exposées
à certaines radiations [on estime sans doute que l'adjectif
indéfini « certaines » suffit à
désigner la
dose considérable de 175 rem.]. Il n'y a pas eu de
brûlures [c'est faux, il y en a eu beaucoup, ainsi que d'autres
troubles]. Aux dernières nouvelles, tout le monde se porte
bien [comme si l'on pouvait déjà savoir, après
les crises de vomissements et de diarrhées, comment les
choses vont évoluer]. » En fait, on fera, plusieurs
années plus tard, une étude médicale très
poussée sur la santé des enfants victimes de Bravo :
elle révélera des cas de croissance retardée,
une épidémie de dérèglements thyroïdiens
et un cas de leucémie.
La CEA est manifestement persuadée que ses affirmations
fallacieuses ne feront l'objet d'aucune enquête publique ;
les îles Marshall ne sont pas le Nevada ! Malheureusement
pour elles, une forte pluie de retombées a touché
un thonier japonais, le
Dragon chanceux [Fukuryu Maru n°5],
qui au moment de l'explosion se trouvait à l'est de l'île
de Bikini, juste en dehors de la zone dite « dangereuse ».
[Le
bilan réel des six tirs de la série Castle (1
mars-14 mai 1954, pour un total de 45 Mt) est longtemps resté
ignoré, caché dans les livres de bord des 992 thoniers
touchés directement ou indirectement (contamination de
la mer) par les retombées des explosions. Il était
aussi enregistré dans les rapports médicaux des
marins, dans les registres des associations de pêcheurs,
et la mémoire des quelque 20 000 marins victimes de ces
essais... voir texte suivant]
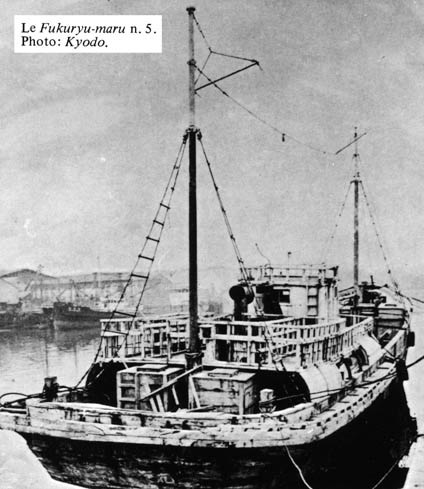
Quand le Dragon chanceux regagne Yaizu, son port d'attache,
à quelque deux cents kilomètres au sud-ouest de
Tokyo, presque tous les vingt trois membres de l'équipage
souffrent d'une forme quelconque de troubles dus aux radiations.
La mésaventure de ces pêcheurs déclenche
une vague de protestations japonaises contre les expériences
atomiques. Les autorités nippones sont obligées
de détruire d'énormes quantités de poisson.
 Photo: Kyodo. L'inspection
du thon au compteur Geiger pour détecter et mesurer la
radioactivité, dans le port de Yaizu. On dut jeter le thon
et autres poissons rapportés par le Fukuryu maru.
Un total de 683 bateaux japonais furent reconnus comme contaminés
par les radiations et 457 tonnes de thon et d'autres poissons
furent jetées.
Photo: Kyodo. L'inspection
du thon au compteur Geiger pour détecter et mesurer la
radioactivité, dans le port de Yaizu. On dut jeter le thon
et autres poissons rapportés par le Fukuryu maru.
Un total de 683 bateaux japonais furent reconnus comme contaminés
par les radiations et 457 tonnes de thon et d'autres poissons
furent jetées.
Six mois plus tard, un des marins, âgé
de trente neuf ans, succombe.
 Kuboyama est
considéré comme la première victime de la
bombe à hydrogène et du tir d'essai Castle Bravo.
Kuboyama est
considéré comme la première victime de la
bombe à hydrogène et du tir d'essai Castle Bravo.
L'un des médecins japonais avance trois hypothèses
à ce décès (1) une hépatite sérique,
causée par une transfusion de sang ; (2) une dégénérescence
du foie occasionnée par les débris d'autres cellules
sensibles à la radioactivité détruites par
l'irradiation ; (3) une lésion directement due à
l'irradiation. Le ton des protestations monte. Les Etats Unis
acceptent la responsabilité de l'accident et par l'entremise
de leur ambassadeur au Japon remettent à la veuve un chèque
d'un million de yens (environ 3 800 dollars).
Extrait de "Les barons de
l'atome",
Peter Pringle - James Spigelman, Le Seuil, 1982.
[Photos rajoutées par Infonucléaire]

Le 1er, mars 1954 restera pourtant le
jour à marquer d'une pierre noire pour les projets d'Eisenhower
et de l'AEC. Une séquence néfaste commence, qui
va troubler la croisade atomique pacifique prêchée
à New York moins de trois mois auparavant. À 6 h
45, heure locale de l'atoll de Bikini, vient d'avoir lieu le tir
Bravo, le premier de la série Castle des essais de bombe
H programmée par l'AEC. Il s'agit de se prouver et de montrer
aux Soviétiques que l'Amérique dispose de bombes
H opérationnelles. Le 25 février, les prévisions
météorologiques à cinq jours étant
favorables aux différentes altitudes où le panache
allait se déployer, la décision a été
prise de tirer le 1er, mars, «si les conditions se maintiennent
». La veille du tir, à 11 heures, le groupe de travail
de Bravo D1 prédit qu'il n'y aura pas de retombées
significatives sur les îles Marshall habitées. La
météo de 18 heures prévoit des vents moins
favorables ; des retombées sur les atolls d'Enewetak et
Ujelang sont en vue. À minuit, les vents ont encore tourné
et c'est l'atoll de Rongelap qui est sur la trajectoire de la
couche à 6 000 m. Bikini et Eneman seront probablement
contaminés. À 4 h 30, « pas de changements
significatifs », les navires et patrouilles aériennes
étant positionnés ainsi que les relais radio, la
décision de tir est finalement maintenue. À 6 h
45, le signal est envoyé et l'engin explose, libérant
une énergie de 15 Mt, le double de celle prévue.
Un cratère de 1,6 km de diamètre d'une profondeur
de 60 m en son centre s'est formé dans le corail sous l'îlot
artificiel au nord-est en bordure d'atoll où a été
placée la charge 23.
Quelques heures plus tard Rongelap et Utirik subissent des retombées
importantes. Leurs populations, quelques centaines de personnes,
ont le temps de recevoir des doses respectivement de 2 Sv et 0,2
Sv, avant d'être évacuées pour trois ans 24... Passé ce
délai, bien que le niveau de contamination résiduelle
y soit encore élevé, elles seront rapatriées
sur la terre de leurs ancêtres où elles font l'objet
d'un suivi médical particulier. En mai 1985, à leur
demande, les trois cents habitants de Rongelap, excédés
par les maux et craintes dus à la radioactivité
de la chaîne alimentaire, seront transférés
par Greenpeace (à bord du Rainbow Warrior, coulé
le 10 juillet suivant par les services secrets français)
sur l'atoll de Kwajalein, distant de 180 km. En 1986, les États-Unis
consentiront une compensation de 150 millions de dollars aux habitants
des îles Marshall, pour solde de tout compte.
La tragédie du thonier japonais Fukuryu Maru 5 (Lucky
Dragon 5) et de son équipage est connue : croisant à
160 km de Bikini (dans le périmètre interdit mais
se croyant protégé par la distance), il est recouvert,
quelques heures après l'explosion, par une couche de poussière
blanche. Comme à leur habitude, des centaines de thoniers
pêchent dans les eaux poissonneuses des îles Marshall,
un vrai paradis. Ces bateaux hauturiers d'une centaine de tonnes,
conçus pour des campagnes de plusieurs mois, sont servis
par des équipages d'une vingtaine d'hommes, à l'époque
en majorité des hommes jeunes qui avaient remplacé
les marins morts au combat durant la guerre. Les veilles radio
sont permanentes. Dans la matinée, le radio du Kouseï
Maru 2, Yamashita Shoïchi, intercepte un court message
du Fukuryu Maru rapportant que « le navire est
recouvert d'une sorte de cendre extraordinairement fine, blanche
comme de la neige ; l'équipage s'affaire au nettoyage ».
Quelques jours plus tard, le radio du Daï Maru 7, Daikoku
Toubeï, reçoit un appel à l'aide de Kuboyama
Aïkichi, le radio du Fukuryu Maru 5 (qui mourra six mois
plus tard emporté par les radiations internes), appel que
Daikoku répercute vers tous les bateaux dans la zone -
« tout l'équipage est malade, souffrant de diarrhée
sévère. S'il vous plaît, pouvez-vous nous
avoir des médicaments ? ». Le 14 mars, le Fukuryu
Maru 5 est de retour dans son port d'attache de Yaïdu.
L'équipage est diagnostiqué souffrant du mal aigu
des rayons. Le 16, la nouvelle fait le tour du japon, puis se
répand dans le monde entier. Le scandale est considérable,
que tous vont s'ingénier à contenir, Américains,
autorités japonaises et même les pêcheurs irradiés,
chacun avec des raisons bien particulières.
La conséquence en
est que le bilan réel des six tirs de la série Castle
(1 mars-14 mai 1954, pour un total de 45 Mt 25) est longtemps
resté ignoré, caché dans les livres de bord
des 992 thoniers touchés directement ou indirectement (contamination
de la mer) par les retombées des explosions. Il était
aussi enregistré dans les rapports médicaux des
marins, dans les registres des associations de pêcheurs,
etc. La mémoire du destin des quelque 20 000 marins victimes
de ces essais se serait perdue sans l'obstination d'un homme,
Yamashita Masatoshi. Au début des années 1980, il
a créé une petite association, le Bikini Atoll Incident
Investigation Group, qui s'est donné la mission de révéler
la dimension inouïe de cette affaire. Il
a rassemblé les résultats de sa longue quête
de vérité et de justice dans un film documentaire,
présenté en 2004 à l'occasion du cinquantième
anniversaire de cette troisième tragédie atomique
japonaise 26.
Une information irréfutable sur la cause des maux qui ont
accablé ultérieurement les marins a été
fournie par le navire de recherche que le gouvernement japonais
a dépêché deux mois plus tard dans la zone.
Les poissons pêchés et rassemblés sur le pont
étaient si radioactifs qu'on pouvait croire avoir affaire
aux retombées elles-mêmes. La situation devint si
dangereuse pour l'équipage tant l'eau était contaminée
que la mission fut interrompue. Pendant ce temps-là, la
pêche continuait, les marins se douchant à l'eau
de mer et se nourrissant exclusivement de poissons frais 27! Les témoignages
sont terribles. Le sort des hommes est, trente ans avant, identique
à celui de nombreux liquidateurs de Tchernobyl. Ils sont
rentrés au port souffrant de nausées et parfois
d'hémorragies internes, marqués par le bronzage
atomique ou par des radiodermites étendues, ayant perdu
leurs cheveux... Apparemment rétablis, ils ont mené
leur vie, une vie raccourcie de vingt à trente ans par
rapport à la moyenne nationale, et bien plus encore si
l'on considère l'espérance de vie de ces populations
de pêcheurs à la santé insolente et à
la longévité légendaire.
 Portrait d'un membre de l'équipage du
bateau de pêche DaiGo Fukuryu Maru (Lucky Dragon n°
5). Hitoshi Yamada
Portrait d'un membre de l'équipage du
bateau de pêche DaiGo Fukuryu Maru (Lucky Dragon n°
5). Hitoshi Yamada
Les causes de décès les plus fréquentes sont
les cancers (une cinquantaine de fois la proportion nationale
dans cette classe d'âge) et les infarctus. Aucun rapport,
ni de la CIPR 28
ni plus tard de I'UNSCEAR, ne fait état d'un quelconque
intérêt pour cette cohorte exceptionnelle, 20 000
hibakusha 29, passée au
compte des pertes et profits de l'énergie atomique. La
« science des radiations» de l'ONU et la « radioprotection
internationale» autoproclamée n'ont eu cure (en dépit
du scandale mondial) de l'existence d'un problème de leur
ressort ni de la réalité humaine dont il était
lourd.
Comme les cancers de la thyroïde de Tchernobyl et de Fukushima
servent d'arbre cachant la forêt des séquelles sanitaires
de ces désastres, réduire la question des dommages
sanitaires des retombées de Castle Bravo et des
tirs suivants au seul bilan du Fukuryu Maru 5 30 a conféré
un caractère exceptionnellement limité à
cet «incident» - lequel, de plus, aurait été
évité (selon les Américains qui ont trouvé
là une faille juridique à exploiter) si le bateau
avait été conduit en dehors de la zone interdite.
L'équipage du Fukuryu Maru 5 était le plus
gravement atteint et le navire a regagné son port d'attache
le premier. Les projecteurs se sont alors braqués sur lui.
Qui aurait eu intérêt
à élargir le scandale aux 991 autres thoniers touchés
durant ces semaines tragiques ? Les Américains ? Évidemment
non. Le gouvernement japonais ? Non et pour plusieurs raisons
: sa faiblesse politique, sa disposition favorable à l'option
de l'énergie atomique et l'importance du secteur de la
pêche du thon dans l'économie du pays. Les équipages,
dont la plupart des matelots et officiers sont jeunes ? Avec des
signes cliniques réversibles à court terme, attirer
l'attention sur eux les aurait marqués hibakusha, et
ils n'auraient pu que difficilement trouver à se marier
ou, s'ils l'étaient déjà, ce serait leur
progéniture qui aurait été ostracisée
; la reprise la plus rapide possible du business as usual,
c'est-à-dire sans suspicion quant à la qualité
des prises, représentait une raison supplémentaire,
économique.
Les complices (du côté de ceux qui savaient) de cette
supercherie ne sont évidemment pas les mêmes que
ceux qui orchestreront, plusieurs décennies après,
le déni des conséquences sanitaires de Tchernobyl
et Fukushima. Cependant, tous, à cette époque comme
une ou deux générations plus tard, traitent ces
problèmes comme s'il serait blasphématoire d'incriminer
les radiations dans les effets sanitaires observés, dès
lors qu'une autre cause « plausible » peut être
avancée. Et si cela n'est pas possible, alors il faut ignorer
ou, si nécessaire et en dernier ressort, nier la réalité
des effets.
Extrait de : La comédie atomique: L'histoire occultée
des dangers des radiations
Yves Lenoir, La Découverte, 2016.
[Photos rajoutées par Infonucléaire]
23 DEPARTMENT OF DEFENSE, US Atmospheric
Nuclear Weapons Tests, Castle Series 1954 », 1982, chapitre
4 ( Bravo Test «).
24 ACHRE, Final Report, op. cit., chapitre 12.
25 Les retombées de ces tirs (qui ont eu lieu au sol ou
sur barge) sont de l'ordre de dix fois celles de Tchernobyl et
sans doute d'une centaine de fois celles de Fukushima. Elles se
sont diluées dans l'océan.
26 The Dead Sea. Testimony of the Victims from the «
Sea of Death », 50 years on, Nankaï Broadcasting,
70 mn, 2004.
27 Les contrôles des prises par les autorités portuaires
cessèrent par décret en décembre 1954. II
est vrai qu'un médecin expert de l'AEC, Gordon Dunning,
avait affirmé depuis le début que les thons pêchés
par le Lucky Dragon devraient être considérés
comme sûrs pour une consommation illimitée ».
28 Excepté un alinéa (214) du rapport The Biological
Basis for Dose Limitation in the Skin (Annals of the ICRP,
vol. 22, n° 1, 1991), dont les onze lignes décrivent
les différents types de blessures cutanées observées
chez les marins du Fukuryu Maru 5 et les habitants de Rongelap.
Le rapport d'ACHRE (op. cit.) y consacre neuf lignes, soulignant
son impact dans la controverse sur les essais.
29 Des bateaux de pêche d'autres nationalités sillonnaient
très probablement les parages. À ma connaissance,
aucune donnée les concernant n'a jamais été
publiée. Les limites de la curiosité des radioprotecteurs
sont de beaucoup inférieures à celles des doses
qu'ils recommandent de ne pas dépasser.
30 Un mort du fait d'une hépatite (version officielle américaine)
contractée lors d'une des multiples transfusions nécessaires
pour tenter de le maintenir en vie, et le reste de l'équipage
remis sur pied après un séjour de l'ordre d'une
année à l'hôpital (quand même).
Le 4 janvier 1955, le gouvernement japonais a échangé des notes officielles avec le gouvernement américain au sujet d'une compensation, parvenant à un règlement politique entre eux pour 2 millions de dollars de compensation de la part de ce dernier en échange du fait que le Japon ne cherchait pas à tenir les États-Unis légalement responsables.
Après cela, le gouvernement japonais a mis fin à toute enquête plus approfondie sur l'incident et n'a versé qu'une somme dérisoire en compensation aux propriétaires des bateaux de pêche exposés (mais pas aux équipages) pour couvrir les pertes qu'ils avaient subies, comme le fait d'avoir dû se débarrasser thon contaminé. Aucune mesure corrective n'a été prise concernant les dommages sanitaires subis par les équipages des navires exposés. Le fait qu'un total d'environ 1 000 navires avec des membres d'équipage compris entre 10 et 20 000 personnes aient été exposés à des retombées radioactives a été enterré et oublié, banalisé dans l'esprit du public au profit d'un incident impliquant uniquement le malheureux Fukuryu Maru 5. [lire la suite]
Bikini: 50
Years of Nuclear Exposure
 Le 1er
mars 1954, à 3 h 40, vingt-trois pêcheurs japonais
se trouvaient à bord d'un bateau de pêche, le Fukuryu
Maru n°5. Ils étaient occupés à pêcher
au milieu du Pacifique à environ 167 kilomètres
au nord-ouest de l'atoll de Bikini, champ de tir de l'armée
américaine, quand un éclair blanc-rougeâtre
fut aperçu à l'horizon en direction sud-ouest. Sept
à huit minutes plus tard, ils entendirent une forte explosion.
On apprit par la suite qu'éclair et explosion avaient été
provoqués par l'essai de la bombe à hydrogène
sur l'atoll de Bikini.
Le 1er
mars 1954, à 3 h 40, vingt-trois pêcheurs japonais
se trouvaient à bord d'un bateau de pêche, le Fukuryu
Maru n°5. Ils étaient occupés à pêcher
au milieu du Pacifique à environ 167 kilomètres
au nord-ouest de l'atoll de Bikini, champ de tir de l'armée
américaine, quand un éclair blanc-rougeâtre
fut aperçu à l'horizon en direction sud-ouest. Sept
à huit minutes plus tard, ils entendirent une forte explosion.
On apprit par la suite qu'éclair et explosion avaient été
provoqués par l'essai de la bombe à hydrogène
sur l'atoll de Bikini.
Environ trois heures plus tard, une fine poussière commença
de tomber sur le bateau ; elle tomba pendant plusieurs heures
et cessa vers midi, recouvrant pêcheurs et poissons d'une
fine pellicule. Après une traversée de deux semaines,
le 14 mars 1954, le bateau contaminé par la poussière
radioactive est de retour au port de Yaizu, préfecture
de Shinoza, au Japon.
" Pendant le retour au port, nous dit le rapport des
chimistes japonais qui s'occupèrent des mesures de la contamination
subie, l'équipage se plaignit de lésions de la peau
et d'une chute de cheveux, dues aux effets directs de la poussière
radioactive, ainsi que de symptômes généraux
tels que malaises, diarrhées, nausées et vomissements
qui avaient été couramment observés parmi
les victimes des bombes atomiques de Hiroshima et Nagasaki. En
entendant les récits des marins, on comprit qu'ils souffraient
d'une maladie des rayons causée par un type différent
de radioactivité de celui qui était associé
aux lésions directes des bombes atomiques d'Hiroshima et
Nagasaki.
" Pour Hiroshima, on avait supposé que les produits
de fission qui étaient tombés dans la partie Ouest
de la ville le jour de l'explosion de la bombe atomique, avaient
causé quelques accidents dus aux radiations parmi les gens
qui s'y trouvaient. On ne connaissait pas leurs détails
et ils étaient souvent cachés par les lésions
directes provoquées par l'explosion de la bombe atomique.
À Nagasaki, une poussière radioactive contenant
de façon évidente certains produits de fission couvrit
tout le quartier de Nishiyama. D'après le premier examen,
qui fut effectué pour la première fois deux mois
après le bombardement, l'influence de la poussière
radioactive sur le corps humain se révéla par une
leucocytose montrant une augmentation du nombre de leucocytes
à environ 30 000 à 50 000 par mm3 dans
certains cas. Il n'y avait cependant aucun symptôme d'accident
par bombes atomiques telles que chute de cheveux, saignements,
etc. On n'observait pas non plus de leucopénie et on n'a
alors relaté depuis, parmi les personnes atteintes, aucun
cas d'accident de radiation qui pourrait être considéré
comme résultant de l'exposition à la poussière
radioactive.
" L'équipage du Fukuryu Maru n°5 passa donc
deux semaines sur leur bateau qui était fortement contaminé
par la poussière radioactive. En plus de ceci, la surface
de leurs corps était contaminée par la poussière
et il y avait aussi une possibilité que des produits de
fission aient pu en partie être absorbés par les
voies respiratoires et digestives. On a pensé, à
cause de cela, que l'équipage de ce bateau souffrait d'une
sorte de mal des rayons différent de celui qu'avaient causé
les blessures de la bombe atomique. "
Les chimistes japonais se rendirent trois fois à bord,
les 19 mars, 21 avril et 16 mai 1954, avec des appareils de mesure.
[...] Les chercheurs japonais estimèrent d'emblée
que la dose totale reçue par l'équipage variait
entre 200 et 500 rems, ce dernier seuil étant alors considéré
comme létal. Ils recueillirent également des échantillons
de cendres radioactives, qu'ils déposent avec précaution
dans un récipient en plomb et rentrent dans leur laboratoire
afin d'examiner de plus près ces mystérieuses cendres
thermonucléaires.

" Ce sont des petites particules sèches qui ressemblent
à des grains de sable blanc plutôt qu'à des
cendres, nous dit le compte rendu d'observation. Diamètre
des particules de 100 à 400 microns. Moyenne : 257
microns. Celles-ci font un faible bruit en tombant. Bien qu'il
y eut des inégalités dans la surface de ces particules
qui éclairées de côté réfléchissent
intensément la lumière, elles paraissent lisses
dans l'ensemble et ressemblent à du verre semi-transparent.
En examinant de plus près, on voit à leur surface
de nombreux grains, gros, analogues à des points noirs.
Le nombre de grains par particule varie de 2 à 4. Quand
on place les particules blanches sur une lame de verre et quand
on les pique avec une aiguille, elles se cassent facilement. "
 Photo:
mars 1970, MORISHITA Ittetsu.
Photo:
mars 1970, MORISHITA Ittetsu.
Après avoir été pris sous les retombées
radioactives des cendres de la mort, le Fukuryu maru n°5
fut acquis par le Gouvernement japonais, transformé et
utilisé comme bateau école de l'Ecole des Pêches,
rebaptisé Hayabusa maru. Mis au rebut en 1966 dans
un coin de la baie de Tokyo. Il fut redécouvert plus tard,
au printemps de 1967, un mouvement de citoyens s'organisa en vue
de la préservation du bateau comme témoin de la
lutte pour le bannissement des armes nucléaires.



Les chimistes japonais nous disent ensuite qu'" il n'y
a aucun rapport direct entre la taille des particules et leur
radioactivité. Quelques particules accusaient une radioactivité
très faible au moment de notre examen, le 16 mai 1954,
soit 77 jours après la chute. Il semble cependant que les
particules présentant des grains noirs accusent une forte
radioactivité. Mesuré au compteur Geiger Müller,
1 mg de cendres donnait 4 218 comptages par minutes. Dans les
mêmes conditions, 0,4 mg de cobalt 60 donnait 7 475 comptages
par minute. "
Pendant ce temps-là, l'armateur du navire ordonne le déchargement
et la vente du produit de la pêche. Conséquence,
le 7 mars 1954, 41 thons arrivèrent au marché central
de Kioti. Alertés, les chercheurs de l'Institut Chimique
se précipitent sur place et prélèvent des
échantillons de ces poissons directement sur le marché.
Une partie de la cargaison ayant déjà été
transformée, les chercheurs se font remettre des produits
manufacturés réalisés à partir de
leur chair, afin d'en analyser la contamination. Résultat ?
" Les analyses des thons montrent que ces poissons n'ont
été contaminé que sur la partie externe de
leur épiderme et on n'a décelé aucune radioactivité
dans les muscles et les arêtes. Au marché de Yaizu,
le même couteau a servi pour enlever les peaux et les muscles
des thons. On n'a cependant décelé aucune contamination
dans les muscles quand le couteau était lavé après
chaque emploi. La contamination des foies de requins pourrait
s'expliquer par le fait qu'ils avaient été prélevés
sur les poissons et laissés sur le pont du bateau. Les
nageoires des requins avaient été laissées
sur le pont pour sécher et leur contamination marquée
pourrait être attribuée au fait que les cendres radioactives
sont tombées sur elles quand leur humidité convenait
à leur pénétration. "
 Des ailerons de requin contaminés sont
testés et déclarés radioactifs par le Dr
Nishiwaki et son épouse américaine, Jane, dans le
port de Yaizu.
Des ailerons de requin contaminés sont
testés et déclarés radioactifs par le Dr
Nishiwaki et son épouse américaine, Jane, dans le
port de Yaizu.
Restait à établir le pronostic vital des marins
de ce bateau. Les cendres radioactives furent donc inoculées
sur des animaux de laboratoire, souris adultes. En résumé,
les chercheurs constatent que les éléments radioactifs
se déposent surtout sur les os. Mais ils ne nous disent
rien du destin sanitaire des 23 pêcheurs irradiés.
Extrait de: Atomic Park. A la recherche
des victimes du nucléaire,
Jean-Philippe Desbordes, Actes Sud, 2006.
[Photos rajoutées par Infonucléaire]