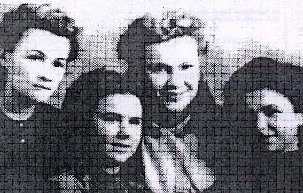 Lida
Bykova, Henrietta Kazmina, Liya Sokhina et Faina Kolotinskaya,
celles qui ont produit le premier plutonium. (1948)
Lida
Bykova, Henrietta Kazmina, Liya Sokhina et Faina Kolotinskaya,
celles qui ont produit le premier plutonium. (1948)Pendant les premières années, les ouvriers de l'usine n'avaient pas droit à des congés ; il fallait un événement extraordinaire pour être autorisés à quitter la « zone ». Ce n'est qu'en 1954, après la mort de Beria, qu'ils y furent autorisés. Mais les contrôles étaient rigoureux.
Nous avons franchi le point de contrôle sanitaire complètement nus, la bouche ouverte pour montrer qu'on ne nous avait rien volé, comme du platine ou de l'or. Ils ont vérifié nos oreilles et nos cheveux, nous ont obligés à écarter les doigts et les orteils, et à faire des flexions. La paume de nos mains posait un problème particulier ; ils les lavaient pendant des heures, mais elles restaient « sales », alors pour passer la sécurité, nous les savonnions. Dans ce cas, les particules alpha étaient indétectables.
Étonnamment, cela ne semblait pas déranger grand monde. Les gens étaient tellement absorbés par leur travail que rien d'autre ne comptait, et le fameux « syndrome du fil barbelé » était totalement absent.
Ils apportèrent donc le premier conteneur de solution concentrée de l'usine radiochimique n°25, située à 20 kilomètres de là. La réception du conteneur fut supervisée par le directeur de l'usine de l'époque, le général Muzrukov, et l'académicien Chernyaev. Ces conteneurs remplirent bientôt tous nos locaux, et les solutions radioactives étaient transvasées à la main dans des verres, sans aucune protection. Il y eut des déversements et des accidents. Un jour, un flacon à parois épaisses se brisa et un éclat de verre contenant du plutonium frappa un jeune technicien à la joue. Désemparés, nous nous mîmes à lui rincer la joue à l'eau directement au-dessus de l'évier. Le contremaître accourut et nous réprimanda pour ne pas avoir pensé à recueillir le sang dans un récipient. Après tout, nous avions dû perdre plusieurs milligrammes de plutonium !
Il y a également eu un accident lié au fait que le plutonium a tendance à chauffer énormément pendant son traitement et sa purification, ce qui peut provoquer une explosion. Nous étions constamment pressés par le temps, nous travaillions à la hâte et nous rebroyions les échantillons sans prendre les précautions nécessaires. Un jour, une explosion s'est produite et tout le plutonium s'est retrouvé au plafond. On l'a ensuite lavé du plafond et des murs dans des cuves à l'aide de papier filtre (l'académicien Bochvar lui-même a participé à cette opération), on a brûlé le papier, on a effectué quelques réparations superficielles et on a continué à travailler dans la même pièce. Pouvez-vous imaginer la quantité de plutonium qu'il y avait ? Des centaines, des milliers de doses !
Ainsi, dans des béchers et des tubes à essai, les premiers milligrammes de plutonium furent obtenus par de jeunes femmes. Fin avril 1948, la technologie était entièrement au point et remise aux métallurgistes. Ces derniers, sous la direction d'Andreï Anatolievitch Bochvar, obtinrent la première « perle » de plutonium, pesant 8,7 grammes.
Toute cette période de production de plutonium métallique, qualifiée de « période du verre », a inévitablement eu des conséquences sur la santé. Nombre de ceux avec qui Liya Pavlovna a débuté sa carrière sont morts très jeunes. Leurs décès étaient dus à une exposition à des radiations des centaines de fois supérieures aux doses autorisées. L'activité alpha était alors négligée ; on pensait qu'une feuille de papier absorbait complètement les particules alpha, et personne n'envisageait la possibilité que des aérosols alpha-actifs puissent pénétrer dans l'organisme. Les médecins eux-mêmes étaient jeunes et encore ignorants de beaucoup de choses, tout comme les scientifiques.
LES VICTIMES NE VOULAIENT PAS QUITTER LEUR POSTE
En août 1948, la période de production sous verre prit fin et le personnel de l'atelier fut transféré dans un bâtiment spécialement construit à cet effet : l'atelier n°1. Mais cela n'améliora que très légèrement les conditions de travail. Dans toute l'histoire de l'industrie nucléaire russe, elles furent sans doute nulle part plus dangereuses qu'à l'atelier chimique et métallurgique de Maïak entre 1949 et 1956. La pollution atmosphérique due aux rayonnements alpha atteignait des dizaines, voire des centaines de milliers de doses. L'usine effectuait principalement des analyses de sang pour détecter les effets des radiations. Mais soudain, de jeunes hommes et femmes commencèrent à souffrir de troubles du sommeil, de crises d'asthme et d'une détérioration générale. Les premiers patients furent tous diagnostiqués avec la même maladie : la tuberculose.
Mais lorsque des personnes âgées de 30 à 32 ans commencèrent à mourir les unes après les autres, les médecins comprirent qu'il s'agissait d'une maladie nouvelle et unique, baptisée pneumosclérose au plutonium. L'usine prit des mesures urgentes pour éloigner le personnel des conditions de travail dangereuses. Des « pétales » de tissu spéciaux, inventés en 1956 et capables de piéger 99% des aérosols, se révélèrent extrêmement utiles. Les médecins travaillèrent avec héroïsme, sauvant des vies et exigeant de la direction qu'elle retire immédiatement les travailleurs malades de la production. Des désaccords surgirent souvent, car il fallait remplacer les travailleurs expérimentés ; le secret joua également un rôle important. Et les victimes elles-mêmes étaient réticentes à quitter leur poste.
« Nous savions ce qu'était la radioactivité, ce qu'était le plutonium. Bien sûr, nous ne comprenions pas toute la dangerosité de cette production, et parfois nous ne pouvions l'éviter (la radioactivité), ce qui était dû en grande partie à notre jeunesse insouciante et, surtout, à notre désir de travailler au maximum de nos capacités. Le plutonium et les femmes sont incompatibles, mais il fallait le faire, et nous y sommes parvenus. »
Liya Pavlovna elle-même pense avoir vécu jusqu'à 70 ans grâce à son envoi à Moscou en 1951 [...], elle n'a donc pas été exposée à la radioactivité pendant deux ans. Aucun de ses collègues des baraquements n'a survécu. Nombre de ceux qui semblaient avoir échappé au danger ont développé un cancer dans les 15 à 20 ans qui ont suivi : cancer du poumon, sarcome du foie et cancer des os.
POURSUIVRE LES RECHERCHES
Après ses recherches, Liya Pavlovna a poursuivi ses études à l'Institut de chimie générale et inorganique de Moscou. Une fois son diplôme en poche, elle est retournée à l'usine et a pris la direction du laboratoire de traitement des déchets. Dans les années 1950 et 1960, l'usine était entièrement jonchée de déchets radioactifs. Les activités de l'Association de production de Maïak ont causé des dommages considérables à toute la région de l'Oural, et plus particulièrement à la région de Tcheliabinsk, au nord du pays.
En 1959, un jeune et dynamique physicien nommé Ternovsky arriva à l'usine et prit la direction du laboratoire central. Il invita Sokhina à devenir son adjointe scientifique. Elle accepta et occupa ce poste pendant seize ans, puis dirigea le laboratoire pendant douze ans. [...]
Parallèlement, Liya Pavlovna entamait la rédaction de sa thèse de doctorat, consacrée à une nouvelle technologie de production de plutonium. Un drame survint alors : ses travaux sur le plutonium eurent des conséquences néfastes sur sa santé. Elle subit une intervention chirurgicale et fut alitée pendant plus de quatre mois. Son immense force de caractère et sa détermination à mener son projet à terme lui permirent non seulement de survivre, mais aussi de reprendre ses travaux scientifiques, de soutenir brillamment sa thèse et de devenir l'une des premières femmes de la ville à recevoir le prestigieux titre de Docteur ès Sciences. Pour sa nouvelle technologie de retraitement des éléments combustibles destinés à l'industrie nucléaire, Sokhina reçut le Prix d'État. [...]
Aujourd'hui retraitée, Liya Pavlovna vit dans la vieille ville d'Ozersk, dans une maison à deux étages entourée de verdure. [...]