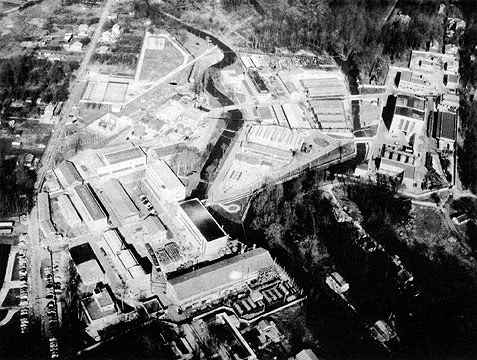
Le Bouchet en 1961, voir: La plaquette de présentation du centre du Bouchet en Pdf, 4,2 Mo (1961),
lire: Le Bouchet, berceau du nucléaire,
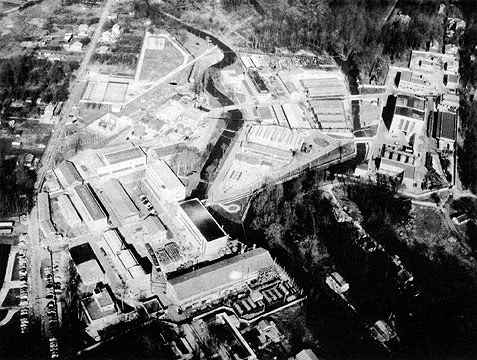
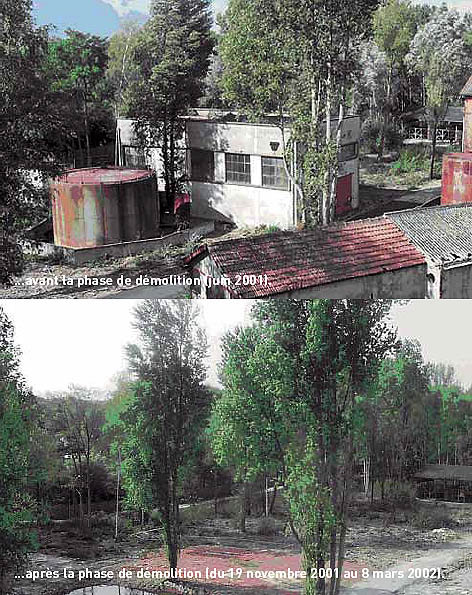
Le Bouchet: où en est-on ?
Se conformant à un arrêté préfectoral,
le CEA a recouvert le site en 1993 d'argile compactée,
de gravier, et de terre arable. Lire: A propos du Bouchet (Gazette Nucléaire
n°161/162, 1997).
Le Monde, 15
novembre 1990:
Pour limiter les émissions radioactives du radon
Des
experts recommandent de recouvrir le site du Bouchet d'une couche
de terre (en Pdf)
Le Parisien,
6 novembre 1991:
Le
préfet met les pieds dans la décharge radioactive
Le Républicain de l'Essonne, 19 septembre 1991:
Décharge radioactive du Bouchet, vers un
réaménagement du site ?
Libération, 14 novembre 1990:
Faut-il recouvrir de terre la décharge nucléaire du Bouchet ou procéder à des fouilles en sous-sol ? Le CEA et la Crii-rad divergent. En attendant du radon, gaz radioactif, s'en échappe toujours.
La polémique rebondit à propos
de la décharge nucléaire du Bouchet près
d'Itteville dans l'Essonne (voir Libération 6/9/90),
où 20 000 tonnes de déchets radioactifs
ont été enterrés naguère par le CEA
(Commissariat à l'énergie atomique) et d'où
se dégage une quantité anormale de radon, du gaz
radioactif, issu de résidus de radium (1).
Un rapport établi par Henri Sergolle, directeur de l'institut
de physique nucléaire d'Orsay, a été remis
au Premier ministre et au ministre de l'Environnement. Sa recommandation
principale est claire: « La solution envisageable
consiste à abaisser le flux du radon et donc l'émanation
de radioactivité, en recouvrant le terrain d'une couche
suffisante de matériau adapté (terre, argile...)
». Il devrait alors être possible de faire
« chuter le taux de diffusion (du gaz radon) d'un
facteur de l'ordre de 100. écartant ainsi tout danger ».
Pas d'accord, estime la Crii-Rad (Commission de recherche
et d'information indépendante sur la radioactivité).
« Ce site doit être considéré
comme un stockage de substances radioactives et rangé parmi
les installations classées pour la protection de l'environnement
» (loi du 19 juillet 1976). « II
doit être soumis au minimum à un régime de
déclaration, avec toutes les astreintes afférentes:
dispositifs de contrôle, conditionnement des substances
radioactives, bâtiments appropriés, etc. ».
La réhabilitation, envisagée en recouvrant simplement
l'endroit d'une couche de terre ne lui semble vraiment pas adéquate.
« Il y a des déchets dans cette décharge
avec des activités telles qu'il faut les reconditionner.
Du radium, très radiotoxique, ce n'est pas acceptable ! »
Et de réclamer (ce qui est d'ailleurs mentionné
dans le rapport) une « expertise par carottage du
sol ».
Autrement dit. il faudrait se décider à aller
véritablement fouiller les terrains. avec une méthodologie
rigoureuse, en particulier un « bassin de décantation
» et le « parc des hydroxydes »,
deux zones particulièrement radioactives. Mais, selon le
rapport Sergolle. « l'exigence des carottages n'est
pas retenue ». La Crii-Rad, associée aux
réunions de travail ayant donné naissance à
ce rapport, regrette que ce dernier ait été publié
« sans qu'on nous ait demandé notre avis.
Cette commission n'a pas le droit de statuer sur la réhabilitation
du site. Il faut appliquer la loi ». En l'occurrence,
on peut se demander au jourd'hui comment va réagir le ministère
de l'Environnement sur cette affaire.
(1) Lire notre grande enquête sur Gif-sur-Yvette (Essonne) parue hier, où l'on voit que le radium cause décidément de nombreux problèmes.
Dominique Leglu
Le Parisien, 13 novembre 1990:
RADIOACTIVITE
La décharge radioactive d'Itteville devrait être bientôt recouverte de terre. Mais la polémique rebondit sur le danger actuel du site.
Bien curieux, l'empressement du Commissariat
à l'énergie atomique à récupérer
les conclusions de Henri Sergolle.
Le directeur de l'Institut de physique nucléaire d'Orsay
présidait la commission chargée de faire la lumière
sur la décharge radioactive d'Itteville (Essonne). Son
rapport a été rendu public hier. Immédiatement,
le C.E.A. a livré son interprétation: « Les
conclusions du professeur Sergolle confirment que le terrain ne
présente aucun risque sanitaire pour la population et valident
les solutions proposées par le C.E.A. pour son réaménagement
», affirme Yves Romestan, chef du service information presse.
« Je n'ai jamais dit ça ! »,
réplique Henri Sergolle, étonné par cette
affirmation du C.E.A. « Le danger actuel du site n'est
pas anodin », poursuit le scientifique, mettant les responsables
du nucléaire français en porte à faux. En
effet, Henri Sergolle n'a jamais conclu sur l'absence de danger.
Il écrit dans son rapport: « La solution consiste
à abaisser le flux de radon
et donc l'émanation de radioactivité, en recouvrant
le terrain d'une couche suffisante de matériau adapté.
Il est raisonnable d'espérer faire chuter le taux de diffusion
d'un facteur de l'ordre de 100, écartant ainsi tout danger.
» Une formulation qui n'a pas grand chose à voir
avec celle du C.E.A.
Il reste que le terrain devrait être tout de même
recouvert sans avoir livré tous ses mystères. « Une
fois encore, le C.E.A. se place au dessus des lois. On doit avant
tout se livrer à des carottages, de nouvelles mesures avant
de se prononcer sur la dangerosité du site », affirme
Michèle Rivasi, présidente de la CRIIRAD, un laboratoire indépendant
qui a effectué des mesures sur le site. Quant au maire
d'Itteville, Michel Fayolle, il affirme que « les taux
de radon dans les habitations sont dix fois sous les normes ».
La décharge, elle, va bientôt être recouverte
par plusieurs mètres de terre, et emporter pour toujours
son secret...
Gilles Verdez
Extrait de La Gazette Nucléaire, n°105/106:
Le Bouchet a priori gérés par le CEA à été laissés sans surveillance pendant une quinzaine d'années. Le Bouchet situé sur la commune d'Itteville envoie ses émanations sur Ballancourt. Ce centre a traité le minerai d'uranium nécessaire pour les réacteurs et les bombes de 1946 à 1971. Ce qui reste à traiter: le bassin de décantation et le parc à hydroxyde (10.000 m2), ce qui reste à vérifier: tout le site qui a été rendu à la SNPE (Société Nationale des Poudres et Explosifs, l'armée en un mot).
Orsay, le 9.11.1990
Monique SENÉ
Présidente du GSIEN
2, rue François Villon
91400 ORSAY
Monsieur le Maire 91760
ITTEVILLE
Objet: Réhabilitation du site du Bouchet.
Référence: Lettre du 6 novembre 1990
Monsieur,
J'ai recu votre courrier du 6 novembre
1990 cité en référence. Il appelle les remarques
suivantes:
Les règles de fonctionnement du
groupe de travail n'ont pas du être comprises de la même
façon par tous les participants. A la suite d'une remarque
justifiée des représentants du CEA lors de la réunion
du 19 octobre 1990, il avait été clairement décidé
que les comptes rendus seraient relus et acceptés par TOUS
les membres avant diffusion. Aucune réunion à laquelle
les représentants des associations auraient été
conviés n'a permis une telle relecture et donc, une acceptation
de ce compte rendu.
Je considère ce texte, signé
par Mr Sergolle, comme, à la rigueur, un document de travail
mais certainement pas comme un rapport définitif et je
ne m'associe en aucun cas aux conclusions de ce document.
Dans ces conditions, j'estime qu'il était
prématuré d'envoyer un tel rapport à Monsieur
le Premier Ministre et à Monsieur le Ministre de l'Environnement.
En faisant cet envoi, vous avez trahi la confiance des Associations
et vous avez induit en erreur les instances officielles.
En tant qu'expert agissant à la
demande des associations, j'estime que le dossier est loin d'être
clos et qu'il est indispensable d'en continuer l'instruction en
respectant un minimum de règles tant sur le plan scientifique
que sur celui de la démocratie.
Espérant une prompte réponse,
recevez, Monsieur le Maire, mes salutations.
La Présidente
Monique Sené
Copie: Monsieur le Premier Ministre
Monsieur le Ministre de l'Environnement
Associations
Orsay, le 11.11.1990
GSIEN
La Gazette Nucléaire
2, rue François Villon
91400 ORSAY
Monsieur le Professeur J. TEILLAC
Haut-Commissaire
31-33, rue de la Fédération
75015 PARIS
Monsieur,
Lors de la réunion du Conseil
Supérieur de la Sûreté et de l'Information
Nucléaire du 10 octobre, il nous a été remis
une fiche d'information concernant le site de l'ancienne usine
du Bouchet.
Pour compléter mon information,
j'ai consulté la note technique remise aux membres de la
commission réunie autour de Monsieur le Maire d'Itteville.
Cette «Note technique relative
aux dépôts de résidus de l'ancienne usine
CEA du Bouchet» (DCENS/SPR/ 90-329 JM/cj) datée du
2 octobre 1990 appelle de ma part de nombreuses remarques, mais
dans un premier temps je me contenterai de vous citer ce qui me
semble le plus inacceptable dans un rapport provenant d'un service
du Commissariat chargé de la radioprotection.
Le tableau 2, page 16, donne une récapitulation
des prélèvements effectués dans les zones
de dépôts entre 1970 et le mois de juillet 1990:
- 87 échantillons sont dénombrés
provenant de 75 points de prélèvement
- 58 de ces points de prélèvement
ne sont pas localisés, ni en position, ni en profondeur.
Ceci pourrait donner à penser
que, dans le passé, le suivi environnement des déchets
n'était pas effectué par le CEA avec tout le sérieux
scientifique auquel nous aurions pu nous attendre. Malheureusement,
la lecture de cette récapitulation fait apparaître
que ces errements datent des années 1970 à 1981.
Il ne s'agit plus de l'époque héroïque des
balbutiements de l'énergie nucléaire.
Cet état de chose est inacceptable
de la part d'un organisme qui se doit d'être irréprochable
puisqu'il est le support technique des services édictant
les réglementations.
D'autre part, je m'étonne que
les autorités de santé n'aient jamais relevé
ces carences.
Je vous joins une analyse détaillée
de ce dossier effectué par le GSIEN et remise le 19 octobre
1990 au groupe de travail réuni autour de Monsieur le Maire
d'Itteville.
Je reste à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires.
Je vous prie d'agréer, Monsieur
le Haut-Commissaire, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Raymond Sené
La réhabilitation illégale du site du Bouchet
M. Sergolle a remis
un rapport final sur le site d'Itteville au nom de la Commission
Scientifique mise en place par le Maire. Ce rapport prétend
refléter la position unanime des différents membres
de cette commission.
Les conclusions de ce rapport n'ont même
pas été discutées avec les membres de la
commission. Rappelons que la CRII-RAD avait souligné que
les chiffres du CEA ne permettaient pas une appréciation
correcte de la contamination du site et demandé instamment
qu'une évaluation par carottage soit menée méthodiquement
pour évaluer les déchets stockés.
Quoiqu'il en soit, la CRII-RAD est en
total désaccord avec les conclusions de ce rapport. En
effet:
- d'une part, de l'avis même du
Ministre de l'Environnement et aux termes de la loi du 19 juillet
1976, ce site doit être considéré comme un
stockage de substances radioactives et rangé parmi les
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement.
Les activités stockées étant supérieures
à 3,7 millions de becquerels de radioéléments
du groupe 1, le site doit être soumis au MINIMUM à
un régime de déclaration, avec toutes les astreintes
afférentes (dispositifs de contrôle, conditionnement
des substances radioactives, bâtiments appropriés...).
- d'autre part, si l'on s'en tient aux
chiffres fournis par le CEA concernant les 2.000 tonnes de déchets
stockés dans le bassin de décantation et 2.500 tonnes
de déchets stockés dans le parc à hydroxydes,
on constate que les limites régissant les centres de stockage
en surface (370.000 Bq/kg pour les émetteurs a), sont largement
dépassées.
En conséquence, la Commission
n'a aucunement le droit de statuer sur une quelconque réhabilitation
du site: la contamination est telle que le site doit être
géré comme un centre de stockage et astreint à
toutes les dispositions prévues par la loi pour assurer
la protection des populations.
Michèle Rivasi
Présidente de la CRlI-RAD
Valence, le 9.10.1990
La réglementation concernant les centres de stockage à long terme de déchets radioactifs stipule que l'activité moyenne des colis de stockage ne doit pas dépasser 370 MBq d'émetteurs a par tonne.
MBq/t: lire Mégabecquerel par tonne.
1 MBq = 1.000.000 Bq
GBq/t: lire Gigabecquerel par tonne. 1 GBq = 1.000.000.000 Bq
Or, les activités massiques des
«stériles de minerais» ainsi que les appelle
improprement le CEA, sont de 413 MBq/t de radium 226, soit, étant
donné la présence de 4 émetteurs a, descendants
du radium 226 et en équilibre avec lui: 413 x 5 = 2.065
MBq/t de matière sèche soit 1.038,5 MBq d'émetteurs
a par tonne de poids humide. Et ceci concerne 2.000 tonnes de
déchets stockés dans le bassin de décantation.
Dans le parc à hydroxydes, sont
stockés 2.500 tonnes dont l'activité massique en
radium 226 est de 156 MBq/t. On a donc, pour les mêmes raisons
que précédemment: 156 MBq/t x 5 = 780 MBq/t d'émetteurs
a par tonne de poids sec, soit 390 MBq d'émetteurs a par
tonne de poids humide. Il faut ajouter, l'uranium 235 et ses descendants,
ce qui donne: 56 MBq/t x 5 = 280 MBq/t de poids sec, soit 140
MBq d'émetteurs a par tonne de poids humide.
On a donc, au total, pour le parc à
hydroxydes: 1.060 MBq/t de poids sec d'émetteur a, soit
530 MBq/t en poids humide. La limite maximale est donc là
aussi dépassée, alors qu'en outre, en ce qui concerne
la chaîne de l'uranium 238, l'activité est sous estimée
puisque le calcul ne concerne que le radium 226 et ses 4 descendants
émetteurs a, les précurseurs du radium n'ayant pas
été mesurés par le CEA.
Une autre limite est fixée concernant
l'activité maximale en émetteurs a: elle est de
3,7 CBq/t. Or un calcul identique au précédent indique
pour l'échantillon n° 67 (cf. tableau 5 page 22) une
activité massique en émetteurs a de 2,5 GBq/t. Ce
qui donne: 2,5 x 5 = 12,5 GBq/t de poids sec, soit 6,5 GBq d'émetteurs
a par tonne de poids humide. Le dépassement de la limite
aurait dû entraîner une procédure exceptionnelle
et obtenir l'agrément spécifique de l'exploitant
du centre de stockage.
On est donc loin des déchets annoncés
«faiblement radioactifs» il y a 6 mois par le responsable
de la décharge. Ce d'autant plus que cette réglementation
correspond au stockage de colis de déchets, enrobés
et conditionnés, entreposés dans des centres de
stockage à long terme (cf. Règle Fondamentale de
Sécurité 8 novembre 1982 révision 1: 19 juin
1984). Il est à noter que l'absence d'enrobage des déchets
ne peut être envisagée que pour des «déchets
de très faible activité» (cf. Art. 6.4), ce
qui n'est évidemment pas le cas, puisque l'on est en dépassement
des limites.
L'absence de gestion de cette décharge
est un bon révélateur de ce qu'il faut absolument
éviter dans les futurs laboratoires souterrains - soumis
aux contrôles des mêmes organismes de tutelle - et
d'une manière plus générale dans tous ce
qui concerne la gestion des déchets radioactifs.
François Mosnier
Responsable du Laboratoire
A la demande de l'association
«Les Amis de la Terre» et des «Verts Ile-de-France»,
la CRII-RAD a procédé à différentes
analyses à proximité du site de stockage d'Itteville
dans l'Essonne.
Deux séries de trois mesures de
radon 222 à l'air libre ont été effectuées,
respectivement du 20 au 22 mai 90 et du 24 au 26 juin 90 (cf.
carte de localisation des points de prélèvement).
Les niveaux mesurés varient de
171 Bq/m3 à 14.110 Bq/m3 (cf. fiche de résultats
d'analyses). Ces niveaux sont très élevés,
notamment ceux mesurés à promimité du parc
à hydroxydes (point de prélèvement n°63).
A titre de comparaison, le taux de radon
extérieur en région parisienne, bien que fluctuant
avec le lieu, l'heure et la saison, est généralement
inférieur à 10 Bq/m3. Une heure d'inhalation d'air
à 10.000 Bq/m3 entraîne une dose de 7 mRem (Réf.
NRPB GS-6) ce qui correspond à la dose reçue habituellement
pendant un an par la population de la région parisienne
qui passerait 3 heures par jour à l'extérieur. Sur
un site minier en exploitation (St-Sylvestre), évalué
en juillet 89 par notre laboratoire, le niveau de radon variait
entre 100 et 1;080 Bq/m3; sur un site minier non-exploité
(Nègremont), évalué au même moment,
il variait de 22 à 200 Bq/m3.
Les points de mesures du radon ne correspondent
pas à des zones de passage. Toutefois, cette zone est accessible
au public, alors qu'aucune indication ne fait état de son
insalubrité. D'autre part, il reste à évaluer
les niveaux de radon présents dans l'environnement plus
lointain et plus passant. En tout état de cause, il paraît
peu sérieux de la part du CEA d'envisager une restitution
du site à usage domestique moyennant simplement quelques
travaux de terrassement. Rappelons que plus les quantités
de radon inhalées sont importantes, plus grand est le risque
de développer un cancer du poumon.
Le radon 222 est un gaz radioactif qui
provient de la désintégration du radium 226. Un
taux de radon très élevé (10.000 Bq/m3) est
donc un indicateur de quantités de radium 226 très
importantes présentes dans la décharge.
Le point le plus important nous semble
donc l'évaluation des quantités exactes de radioéléments
stockées dans la décharge et notamment les quantités
de radium 226. En effet, ce corps radioactif très radiotoxique
(plus que le plutonium) est très soluble dans l'eau. Tout
stockage est donc susceptible de donner lieu à des phénomènes
de lessivage du radium qui va ainsi se trouver dans les eaux de
ruissellement ou de nappe et contaminer l'environnement.
Deux mesures ont été effectuées
dans l'eau, à promixité du site (cf. fiche de résultats
d'analyses). Elles ne montrent pas de présence de radium
226. Cependant, deux autres analyses effectuées sur des
sédiments et des mousses montrent qu'à certaines
occasions, il y a bien contamination en radium 226 par lessivage
ou par phénomène éolien (cf. fiche de résultats
d'analyses). Il est donc nécessaire de faire un bilan plus
global, et plus systématique dans le temps, de la contamination
en radium 226 de l'environnement.
En effet, lorsqu'il est ingéré,
ce corps radioactif très radiotoxique se fixe à
la surface des os, provoquant ainsi leucémie et cancer
des os. Lorsqu'il est inhalé (par exemple après
mise en suspension éolienne), il provoque le cancer du
poumon. A titre indicatif, l'absorption d'une eau qui serait contaminée
à 1 Bq/l de radium 226 consommée régulièrement
entraînerait une dose annuelle de:
- 66,4 mRem chez un enfant de 1 an
- 26,4 mRem chez un enfant de 10 ans
- 21,7 mRem chez un adulte
(Ref. ISH 1985)
En conclusion, les niveaux mesurés
en radon 222 par le laboratoire de la CRII-RAD sont en contradiction
avec les valeurs données dans la publication du CEA de
mai 1990. Le CEA n'a donc pas fait un contrôle rigoureux
et précis de la décharge d'Itteville, qui est pourtant
sous sa responsabilité.
Il nous paraît donc urgent de procéder
à une contre-expertise pour déterminer tous les
radioéléments présents et leur quantité.
Seule une étude plus poussées permettrait de voir
s'il existe des points d'accumulation plus importants et d'apprécier
l'impact de la décharge sur la chaîne alimentaire
et l'environnement.
Michèle Rivasi
Présidente de la CRII-RAD
Pour éviter
tout commentaire sur le dossier d'Itteville destiné à
acréditer l'idée que les associations ont grossi
leurs problèmes d'accès au dossier, voici la présentation
des dossiers CEA successifs. Bien sûr, le dernier en date
d'octobre 90 n'est pas présenté parce que trop épais
(80 pages), mais il y a un commentaire à son sujet (la
note remise au Conseil Supérieur tenait sur un ticket de
métro d'où la nécessité de consulter
d'autres notes). Mais de notes en notes, on constate une constance
remarquable du CEA dans la non présentation des archives
du site.
Il y a également un problème
d'interprétation de la loi à propos des dépôts
et décharges.
Et il y a un problème de suivi
du site. 58 points sont non localisés, ce qui exclut de
faire une véritable étude de la radioactivité.
Les deux derniers points sont:
- on ne peut pas faire de travaux
si on ne connaît pas la cartographie du site. D'une part,
on risque d'irradier et contaminer le personnel, d'autre part
que va-t-il se passer pour l'environnement?
- on ne peut pas rendre un site avec
des restrictions du genre «ne pas faire de construction
nécessitant des fouilles de plus de 50 cm». On a
vu le résultat à Gif-sur- Yvette où on a
dû décontaminer des pavillons construits dans le
coin de la route du radium.
Quant au planning des travaux, il
était déjà tout prêt.
L'inconvénient est que les
mesures de la radioactivité fournies jusqu'à ce
jour sont inexploitables et ne permettent aucun suivi.
On ne voit pas pourquoi les mesures qui seraient fournies maintenant
seraient mieux. Sans la CRI/-RAD, le dossier serait resté
vide. Il nous faut continuer à exiger un véritable
assainissement du site.
1. Généralités
- Date de création du Centre:
1946
- Mission: fournir l'oxyde d'uranium
destiné à la préparation du combustible de
ZOE (premier réacteur expérimentaI français),
traitement des concentrés uranifères et mise au
point des procédés de fabrication des combustibles
des centrales uranium naturel - graphite gaz.
- Fermeture du Centre: 1er octobre 1971.
Les terrains et bâtiments constituant
le Centre ont fait l'objet d'un bail passé en 1948 entre
la Direction Administrative du Commissariat à l'Energie
Atomique (CEA) et la Direction des Poudres au Sous-Secrétariat
d'Etat à la Défense Nationale.
2. Assainissement radioactif du Centre
Après quelques travaux effectués
par la Direction des Productions en 1971, l'assainissement est
entrepris à partir du 1.1.1972 sous la responsabilité
du Directeur du CEA-CEN/SACLAY*; il s'achèvera en mai 1979,
par la remise des locaux et terrains à la Société
Nationale des Poudres et Explosifs (SNPE).
Cette remise à disposition effectuée
après contrôle du Service Central de Protection contre
les Rayonnements lonisants (SCPRI) est assortie d'une convention
qui prévoit en particulier l'intervention du Service de
Protection contre les Rayonnements (SPR) du CEA-CEN/SACLAY en
cas de travaux d'affouillement; cette clause a été
mise en application à plusieurs reprises (avril 77, juin
78, juin 79, juillet 83).
Bilan général d'assainissement:
Décontamination de 10.400 m2 de
surfaces verticales ou horizontales de bâtiments et de 28.000
m2 de terrains ou de surfaces aménagées. 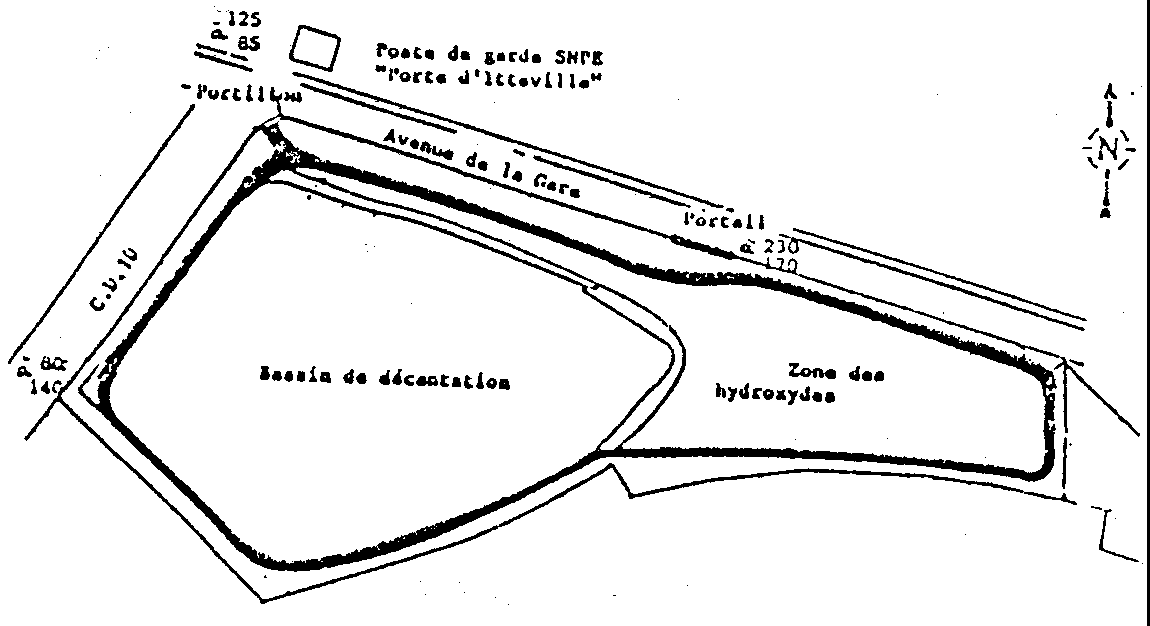
3. Dépôt de résidus extérieur au Centre,
pour lequel la consultation du SCPRI est en cours
Si les travaux d'assainissement du Centre
sont terminés, il subsiste à proximité un
dépôt annexe constitué par le bassin de décantation
et le parc à hydroxydes.
3.1. Bassin de décantation
· Surface du terrain: 10.500 m2
(appartenant à la SNPE)
· Surface utile: 5.000 m2
· Contenu: 15.000 tonnes environ
de boues et terres (activité totale en Ra226**: 15 curies).
3.2. Parc à hydroxydes
· Surface: 3.500 m2 (appartenant
à la SNPE)
· Sont entreposés environ
2.000 tonnes d'hydroxydes et 2.500 tonnes de terres (activité
totale en 226 Ra: 5 curies).
4. Surveillance de l'environnement
4.1. Surveillance des eaux - 226 Ra
Les eaux de surface font l'objet de prélèvements
et de mesures tous les 3 mois depuis 1982. Points de prélèvements:
122/amont et 125/aval (Juine) et P5 (Ruisseau Centre de Recherche
du Bouchet).
Les 3 points de prélèvements
sont indiqués sur la figure 1: la valeur moyenne se situe
au niveau du 2/1.000 de la valeur admise pour le public (limite
dérivée de la concentration dans l'eau pour le public)
et la valeur maximale est de l'ordre de 1% de cette même
limite. Ces valeurs correspondent à l'activité moyenne
des eaux de surface en France.
4.2. Mesures de rayonnements
Les valeurs indiquées sur le schéma
joint (figure 2) montrent que l'irradiation en limite de site
est toujours sensiblement inférieure à la limite
d'exposition pour une personne du public qui y séjournerait
en permanence.
Les aménagements
prévus réduiront encore ces valeurs pour les amener
au niveau de la radioactivité naturelle de la région.
4.3. Mesures du radon
Des mesures récentes faites par
l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire
(IPSN) ont montré que pour le point le plus exposé,
c'est-à-dire le poste de garde du Centre de Recherche du
Bouchet, la valeur atteinte correspond à l'activité
moyenne du radon dans les habitations françaises. Elle
sera encore réduite après les aménagements
projetés.
Commentaire Gazette: L'activité
de 1 millicurie par tonne classe ce dépôt dans la
catégorie installation soumise à autorisation, d'autant
plus que la quantité totale «stockée»
sur le site est de l'ordre de 50 Curies.
* CEN/SACLAY: Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay.
** Le radium 226 est un élément naturel présent
dans tous les minerais uraniféres. Rapportée au
tonnage, cette activité est de 1 millième de Curie
par tonne, ce qui est considéré comme faible.
L'assainissement de
l'ancienne usine CEA du Bouchet s'est terminé en 1979 par
la remise à disposition de la SNPE de différents
terrains et bâtiments situés au nord de l'Avenue
de la Gare, reliant Itteville à Ballancourt.
Un terrain annexe, situé de l'autre
côté de cette Avenue de la Gare, va faire à
son tour l'objet d'une opération de remise en état.
Ce terrain de 14.000 m2 est occupé,
d'une part par un ancien bassin de décantation et, d'autre
part, par un stockage de résidus de traitement de minerai
d'uranium.
Les matériaux ainsi stockés
sont stables chimiquement mais présentent une radioactivité
naturelle résiduelle. Cette radioactivité est assez
faible pour que l'on ait pu garantir l'innocuité du terrain
vis-à-vis de l'environnement, des contrôles[1]
précis, effectués régulièrement depuis
1982, ont permis de le vérifier.
Par ailleurs, des relevés systématiques
effectués dans les cours d'eau avoisinant donnent un taux
de radioactivité 10 à 1.000 fois inférieur
aux normes tolérées pour la fréquentation
humaine permanente[1].
Mais ce terrain est inutilisable dans
son état actuel (présence de monticules, dépression
de la fosse de décantation ... ). Par ailleurs, des progrès
ont été accomplis pour améliorer encore les
conditions de stockage de déchets faiblement radioactifs
tels que ceux qui sont ici à prendre en compte. Le CEA
va donc entreprendre les travaux nécessaires pour rendre
le terrain à la SNPE dans un état proche de son
état initial, tout en réduisant encore sa radioactivité
pour la ramener au niveau de celle des terrains environnants.
La solution technique retenue a été
proposée aux autorités de sûreté (SCPRl).
Elle se décompose en deux temps: disposer uniformément
les résidus dans le bassin de décantation, et recouvrir
l'ensemble de matériaux essentiels naturels (argile, sable,
terre végétale).
Des restrictions d'utilisation sont,
au demeurant, à envisager:
- pas de construction sur la partie bassin
de décantation, une évidence, ne serait-ce qu'en
terme de stabilité,
- pas de construction nécessitant
des fouilles de plus de 50 cm sur le reste du terrain.
La SNPE les a formellement acceptées.
Les conditions techniques et juridiques
sont donc actuellement réunies pour entreprendre à
mener à bien l'assainissement final de ce terrain en vue
de sa restitution à la SNPE.
La durée des travaux est prévue
sur une année, période durant laquelle le CEA poursuivra
ses contrôles avec la même régularité
que ceux effectués depuis 1982, mettant en place parallèlement
des mesures spécifiques complémentaires, assurant
de cette manière une pleine sécurité.
Enfin, à l'achèvement des
travaux, un dispositif de surveillance de l'environnement, au
plan de la radioactivité et de son évolution, sera
mis en place selon les directives du service central de protection
contre les rayonnements ionisants (SCPRl).
1. L'ensemble
des résultats de ces contrôles peuvent être
obtenus sur demande auprès du CEA/UDIN/FAR.
NDLR: N'hésitez pas à les demander, cela vous
permettra de constater que les relevés ne sont pas faits
sur le site des bassins.
Le site et son environnement
La connaissance des éléments radioactifs présents sur le site et l'expérience acquise sur les terrains comparables sur les sites miniers montrent que les nuisances potentielles sont liées d'abord au radon, ensuite au radium et de façon très secondaire à l'uranium. Ce terrain contient une vingtaine de grammes de radium.
Qu'est-ce que le RADON ?
C'est un gaz radioactif que l'on rencontre
surtout dans les sols et la basse
atmosphère.
C'est un gaz rare de la famille des krypton,
argon, xénon. Il existe depuis la nuit des temps puisqu'il
est issu de la désintégration du radium, lui-même
descendant de l'uranium naturel.
Son "père", le radium,
est plus ou moins présent dans les roches. Le radon, ainsi
formé, se glisse par toutes les fissures, interstices et
pores du sol et des matériaux de construction, pour arriver
à l'air libre. On le trouve partout, même dans les
eaux. Sa teneur varie suivant la nature des sols et la facilité
qu'il a de pouvoir en sortir.
Il produit lui-même des descendants
radioactifs solides. Son activité est exprimée en
becquerels par m3 (Bq/m3) d'air.
A l'air libre, la teneur en radon dépend:
- de la nature du sol: dans le bassin
parisien, reglon sédimentaire pauvre en uranium, la teneur
moyenne annuelle atteint, et parfois dépasse, 20 Bq/m3,
tandis que dans les régions granitiques (Bretagne,
Limousin, Massif Central, Vosges), elle peut aller jusqu'à
200 Bq/m3. Au-dessus des océans, la concentration du radon
est à peine décelable (moins de 1 Bq/m3);
- des conditions de diffusion dans l'atmosphère:
lorsqu'elles sont défavorables, c'est-à-dire la
nuit et par temps de brouillard, des teneurs 10 à 20 fois
plus élevées sont mesurées.
A l'intérieur des habitations,
la teneur en radon est généralement plus élevée
qu'à l'air libre. Elle dépend principalement de
la nature du sol, mais d'autres facteurs interviennent: essentiellement
la ventilation des locaux. Les études faites ces dernières
années en France montrent que les teneurs varient de 10
à 200 Bq/m3 ; 80% d'entre elles sont inférieures
à 100 Bq/m3. Des valeurs de quelques milliers de Bq/m3
ont été mesurées dans des maisons mal ventilées,
en granit, sur sol granitique.
L'inhalation est la voie d'exposition
de l'homme par le radon et ses descendants radioactifs.
Pour le public qui est soumis à
de faibles doses, aucune conséquence sanitaire en relation
avec l'exposition au radon n'a été mise en évidence.
Toutefois, la Commission des Communautés
Européennes propose l'adoption de mesures de réduction
dans les maisons anciennes à partir de 400 Bq/m3.
La concentration de radon qui varie de façon importante
selon les conditions atmosphériques et l'heure a fait l'objet
d'une surveillance sur le site et son environnement. Elle atteint
les valeurs suivantes:
· Plusieurs milliers de becquerels par
m3 d'air en moyenne, sur le terrain. La concentration est proche
de la limite pour les travailleurs qui y séjourneraient
tout leur temps de travail.
· Plusieurs centaines à
un millier de becquerels par m3 d'air en moyenne à la clôture.
· L'activité sur les voies
de passage aux abords du terrain (avenue de la Gare et Chemin
rural n°10) avoisine la limite imposée par la réglementation
pour le public qui y séjournerait de façon permanente.
Cette activité est comparable
à celle que l'on trouve, à l'intérieur de
maisons de régions granitiques telles le Limousin ou la
Bretagne.
·
L'activité décroît ensuite très rapidement
à quelques centaines de mètres pour rejoindre la
valeur de la région parisienne (15 à 20 Bq/m3 d'air).
Quant au radium et à ses descendants
solides, les contrôles réguliers n'ont pas mis en
évidence plus que des traces d'un passage dans les eaux
de surface (Juine, bras de l'Essonne, étang des hirondelles)
ou dans les eaux souterraines (stations de pompage et puits de
jardin). Il faut souligner qu'il se trouve dans le terrain mélangé
à la terre, sous forme quasiment insoluble.
La radioactivité du radium mesurée
dans les eaux de surface et les eaux souterraines autour du site
est inférieure ou proche du seuil détectable (0,22
becquerel par litre).
La limite de concentration pour le public
est de 7,4 Bq/l. Certaines eaux minérales présentent
une concentration supérieure à 1 Bq/l.
Notons, enfin, pour être complet,
que les produits radioactifs émettent un rayonnement mesurable
sur le terrain lui-même. Mais il devient très faible
dès les abords immédiats et il ne pose pas de problème
pour l'environnement.
Une campagne de mesures de concentration
en radon à l'intérieur des habitations qui durera
plusieurs mois vient de s'engager en concertation avec les mairies
concernées à Itteville et à Ballancourt.
Les résultats des surveillances
effectuées par le CEA sont communiqués au Préfet,
aux mairies et aux administrations.
Le terrain est réaménagé
pour permettre sa restitution à son propriétaire,
la SNPE.
Il s'agit d'opérations de nettoyage,
d'applanissement, de recouvrement par une couche d'argile puis
de terre végétale.
Ce réaménagement permettra
de réduire de façon importante les émissions
de radon ainsi que le rayonnement que l'on mesure sur le terrain
lui-même et éliminera tout risque d'entraînement
des terres par ruissellement: l'objectif recherché est
de ramener sur le terrain lui même, la concentration de
radon et le rayonnement aux niveaux de la région Ile de
France.
Les différentes étapes
sont les suivantes:
1. Etat initial
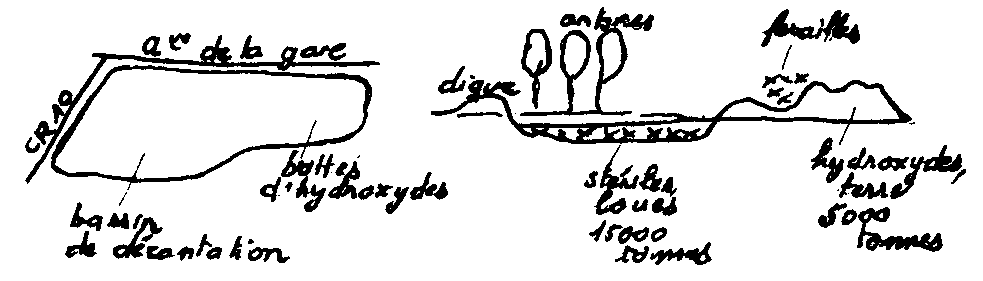
2. Travaux préliminaires (durée 8 semaines)
· Aménagement du chantier
· Evacuation des ferrailles
· Débroussaillage du terrain.
Une cartographie des émissions
de radon et de rayonnement sera réalisée à
la fin de ces travaux préliminaires.
3. Mise en place de la couche d'argile
La durée prévue pour les
travaux de terrassement (non compris le temps nécessaire
pour la stabilisation des sols) est de 4 mois si les conditions
météorologiques sont favorables.
· Transfert des hydroxydes dans
le bassin de décantation.
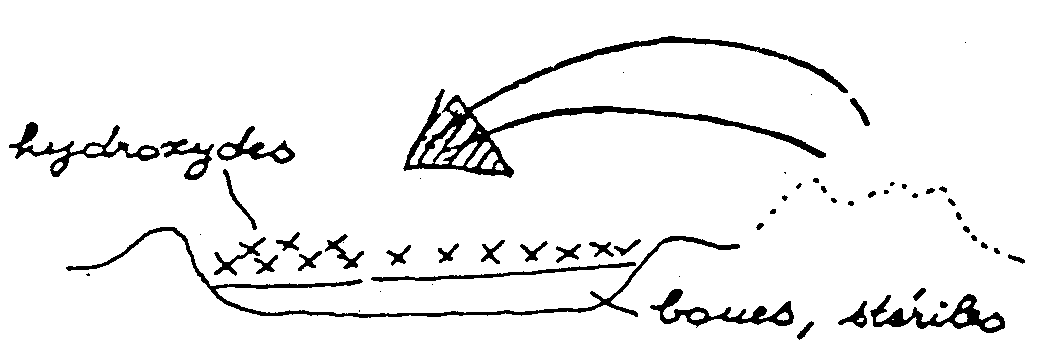
· Mise en place d'un treillis
métallique et d'une membrane géotextile permettant
d'éviter le mélange des matériaux par les
roues des engins de travaux publics au moment de la réalisation
de la couche d'argile.
· Mise en place de la couche de
30 cm d'argile.
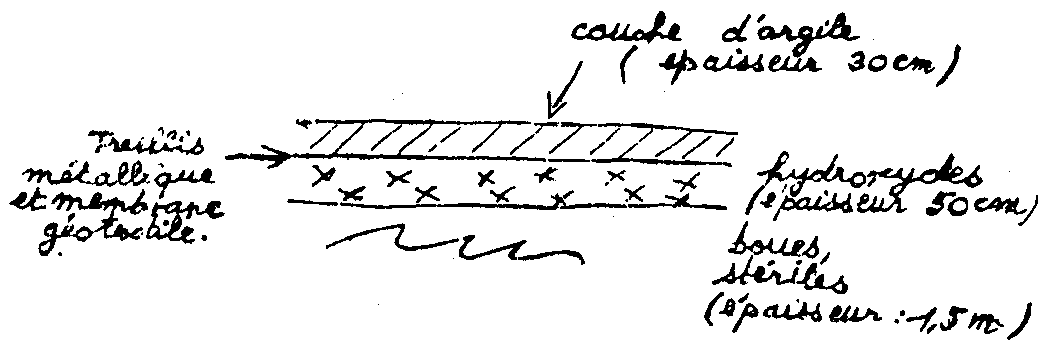
4. Vérification des résultats obtenus
A l'issue de cette phase, des mesures
de radon et de rayonnement seront effectuées par le Service
de Protection contre les Rayonnements du Centre de Saclay et l'Institut
de Protection et de Sûreté Nucléaire. D'autres
laboratoires qui seraient intéressés pourront y
être associés.
Si les résultats sont insuffisants,
une couche d'argile supplémentaire sera mise en place.
5. Mise en place des matériaux de recouvrement
Les matériaux de recouvrement
sont constitués d'une couche drainante puis de terre végétale
(épaisseur 30cm).
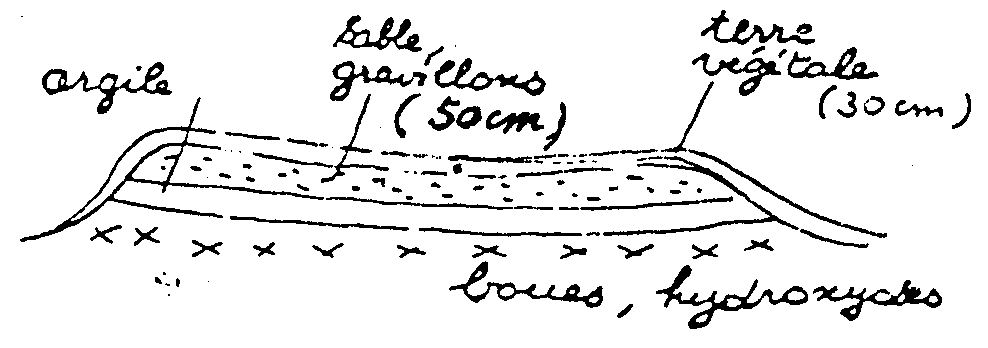
6. Travaux de finition
· Engazonnement
· Rectification du carrefour.
Des échantillons, notamment de
flore et de terre prélevés pour conservation à
chacune de ces étapes pour conserver une mémoire
du terrain.
Les travaux sont réalisés
sous la responsabilité du Directeur du Centre de Saclay
par une unité spécialisée du CEA.
Ils sont effectués en concertation
avec l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire
sous l'autorité du Préfet et sous le contrôle
de la Direction Régionale de l'Industrie et de la Recherche
(DRIR)
Les mesures finales de radon et de rayonnement
seront effectuées sous le contrôle du Service Central
de Protection contre les Rayonnements lonisants du Ministère
de la Santé (SCPRI).
La restitution du terrain à la
SNPE, propriétaire, se fera après l'achèvement
complet des travaux de réaménagement.
Le dossier formalisant la demande de
travaux synthétisée dans ce document a été
déposé en Préfecture (Bureau de l'Environnement)
et fait l'objet d'une instruction dans le cadre de la réglementation
relative aux Installations Classées pour la Protection
de l'Environnement. Les travaux ne pourront être engagés
qu'après qu'ils auront été autorisés
par un arrêté préfectoral après avis
du Conseil Départemental d'Hygiène.
Différence entre dépôt
et décharge
D'après le CEA, Itteville et Saint-Aubin
sont des dépôts. C'est-à-dire que ce sont
des endroits où on dépose des produits nocifs: endroit
surveillé en permanence par une présence sur
site et par des mesures dans l'environnement.
Les décharges sont les endroits
où on met ce qu'on veut oublier. De toute façon,
les décharges doivent aussi être surveillées
mais comme ce sont seulement des installations classées,
on ne peut pas y mettre de produits radioactifs (aucun émetteur
a par exemple).
Différence entre assainir et réhabiliter
D'après le CEA, assainir signifie
que le site est rendu à son propriétaire mais qu'il
y a des restrictions quant à son utilisation et qu'il faut
encore surveiller l'environnement.
Réhabiliter signifie que l'on
rend le site sans astreinte.
Une fois ces prémices posés,
on pourrait peut-être partir des textes. Pour ne prendre
que le Groupe 1 qui rassemble surtout les éléments
émetteurs a, les dépôts et stockage sous forme
de source non scellée sont limités à:
- Activité totale égale
ou supérieure à 0,1 Curie (3.700 mégabecquerels)
mais inférieure à 1.000 Curies (37.000 gigabecquerels).
L'installation est soumise à déclaration.
- Activité totale égale
ou supérieure à 1 millicurie (37 mégabecquerels)
mais inférieure à 100 millicuries (3.700 mégabecquerels),
l'installation est soumise à déclaration.
Donc Itteville, site du Bouchet,
ne peut pas être une décharge conventionnelle:
avec une estimation entre 20 et 100 g de radium (en prenant les
chiffres CEA dont on ne peut être sûr) soit entre
20 et 100 Curies, il s'agit d'une installation soumise à
autorisation.
|
L'Express
du 11 août 1989 a publié un entretien Cousteau/Rocard.
Nous avons relevé la phrase suivante de Michel Rocard:
«Pour la sécurité nucléaire, nous
payons quatre fois plus que les Soviétiques et deux fois
plus que les Américains». |
Le Monde, 11
juillet 1990:
Taux
de radon record dans l'Essonne
Le Parisien, 28-29 avril 1990:
Depuis 1971, cette « poubelle » radioactive voisine avec les onze mille habitants de trois communes de l'Essonne. Mais toute la zone pourrait être assainie cette année.
Ballancourt, Itteville, Vert-le-Petit (Essonne), trois villages d'apparence paisible.
Au centre de ce triangle, un terrain vague entouré de barbelés. Onze mille habitants qui ne soupçonnent pas la présence de vingt mille tonnes de déchets radioactifs à quelques centaines de mètres de leurs pavillons ! Un secret soigneusement dissimulé depuis vingt ans...
Les déchets sont « faiblement radioactifs: des stériles
de minerai dans un bassin de décantation, des hydroxydes
d'uranium dans un parc contigu », précise
la direction de la Société nationale des poudres
et explosifs (SNPE), propriétaire du terrain, dans son
document confidentiel. En clair, de source officielle: « Pas
dangereux, sauf si un homme y habite pendant dix ans ! »
D'après un spécialiste de l'unité de décontamination
des installations nucléaires, « l'enclos va
être assaini pour le rendre au propriétaire. Il était
même question d'y installer un terrain de football !
Des mesures sont effectuées fréquemment, le taux
de radioactivité est faible. Mais le Commissariat à
l'énergie atomique est sur le qui-vive ! »
Les déchets proviennent de la décontamination de
l'ancien C.E.A. du Bouchet, fermé en 1971. Jusqu'en 1979,
la « décharge » a été
remplie progressivement.
C'est le symbole des débuts difficile du retraitement des
déchets nucléaires en France: la terre et l'eau
ont été expédiées dans les mines de
La Crouzille (Massif central). Le reste, des résidus de
minerai, coûtait trop cher à transporter. Alors,
des camions « balancent » les déchets
dans un terrain vague, en face de la S.N.P.E.. Le terrain est
clôturé, le tour est joué... A 40 kilomètres
du sud de Paris, la première poubelle radioactive française
est née.
« Les gens dans le secret, appellent
le terrain le champ de la mort. Si on creuse, des tonnes de petit
matériel utilisé lors de la décontamination
vont apparaître: gants, masques... », affirme Alain
Coste, des Amis de la Terre, qui travaille depuis des années
sur le dossier. Information impossible à confirmer pour
le moment. La poubelle radioactive n'a peut-être pas livré
tout son contenu. En tout cas, le maire d'Itteville, Michel Fayolle,
avoue « être un peu apeuré. Mais je suis
bien obligé de croire ce que le C.E.A. me dit... »
Le Bouchet: berceau du nucléaire
1947: l'usine du Bouchet (C.E.A) voit le jour. Première
usine française de fabrication d'uranium. Au fil des ans,
sa capacité annuelle passe de dix à cinq cents tonnes.
1959: le site de Malvesi relaye le Bouchet et fournit à
son tour de l'uranium.
1971: le Bouchet ferme. Le site est décontaminé
de 1973 à 1975 essentiellement. L'opération est
achevée en 1979: vingt mille tonnes de déchets radioactifs
sont rejetées en face.
1989: en octobre, un délégué du personnel
interroge la direction de la Société nationale des
poudres et explosifs sur l'avenir du terrain loué au C.E.A.
Des travaux doivent être entrepris avant le 1er décembre
1990 pour « assainir le site » sous
contrôle du Service central de protection contre les rayonnements
ionisants. Aucune mesure n'a été rendue publique.
Sur le site, le taux de radioactivité serait « plus
élevé que sur un site vierge, mais sans conséquence
sur l'environnement ».
Gilles Verdez