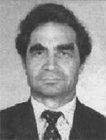 Ivan
Grigorievich Tepliakov, chef du laboratoire des technologies spéciales
et actuellement ingénieur au laboratoire de surveillance
des radiations du Laboratoire central de l'usine, a participé
aux opérations de décontamination après les
accidents de 1957 et 1986. Inventeur soviétique, il a consacré
toute sa carrière à la dépollution des zones
contaminées par les radionucléides.
Ivan
Grigorievich Tepliakov, chef du laboratoire des technologies spéciales
et actuellement ingénieur au laboratoire de surveillance
des radiations du Laboratoire central de l'usine, a participé
aux opérations de décontamination après les
accidents de 1957 et 1986. Inventeur soviétique, il a consacré
toute sa carrière à la dépollution des zones
contaminées par les radionucléides.- Ivan Grigorievich, quelles étaient les conditions préalables à la création d'une station de recherche expérimentale sur le territoire de la Trace de Rayonnement de l'Oural (VURS) ?
Les spécialistes et les ouvriers de Mayak se virent confier une tâche dont dépendaient la sécurité et l'indépendance du pays : atteindre la parité avec les États-Unis en matière d'armes nucléaires.
Toutes les ressources étaient disponibles pour résoudre le problème ; seul le temps manquait. Le développement technologique progressait à une vitesse fulgurante. Dans cette course effrénée pour rester compétitif, il ne restait plus une minute pour créer des systèmes de confinement des déchets radioactifs parfaits. Dans une usine radiochimique, des déchets de haute activité étaient stockés dans des réservoirs afin de réduire leur radioactivité. Un refroidissement insuffisant provoqua une explosion dans l'un des réservoirs. L'incident se produisit le 29 septembre 1957, à 16 h 20, un dimanche ensoleillé. Sur les 20 millions de curies de radioactivité stockés dans le réservoir, deux millions furent libérés dans l'atmosphère à une altitude d'un kilomètre, tandis que le reste se dispersa. L'explosion créa un nuage qui se déplaça vers le nord-nord-est et traversa les anciens villages de Berdyanish, Satlykovo, Galikayevo, Russkaya Karabolka, ainsi que plusieurs villages du district de Bagaryaksky. La traînée atteignit 300 kilomètres de long et 50 kilomètres de large. [Une zone de 1 000 kilomètres carrés de contamination radioactive fut jugée inhabitable], et la superficie totale de la contamination était d'environ 23 000 kilomètres carrés (régions de Tcheliabinsk, Sverdlovsk et Tioumen).
Dans les dix premiers jours, les habitants des villages de Berdyanish, Satlykovo et Galikayevo (1 100 personnes) ont été évacués d'urgence. Leurs biens personnels, leur bétail et leurs volailles ont été détruits. En un an et demi, plus de 10 000 personnes ont été relogées. Après la délimitation de la zone contaminée, 59 000 hectares dans la région de Tcheliabinsk et 47 000 hectares dans la région de Sverdlovsk ont été mis hors d'usage. Plus de la moitié de cette superficie était constituée de terres agricoles : cultures, pâturages et prairies. Outre la nécessité de prendre des mesures immédiates pour protéger la population des radiations, la question de la remise en culture des terres contaminées est devenue tout aussi urgente. Pour y remédier, il était indispensable de démontrer scientifiquement la faisabilité même de la reprise de l'activité économique et de développer et tester des méthodes et des techniques d'organisation et de gestion de la production végétale et animale sur des terres agricoles contaminées par la radioactivité.
- C'est à ce moment-là qu'ONIS a été créé ? Qui l'a organisé ?
Le 28 avril 1958, le ministre de la Construction mécanique moyenne, E. P. Slavsky, signa un décret portant création de la Station de recherche expérimentale (ONIS), dont la direction scientifique fut confiée à l'académicien Vsevolod Mavrikievich Klechkovsky de l'Université de Vasco de Lagos (VASKhNIL). Des spécialistes de l'entreprise, ainsi que des chercheurs du Laboratoire central, de l'Institut de recherche biologique et de nombreux autres instituts de recherche, participèrent à la résolution de ce problème.
Gleb Arkadyevich Sereda, qui dirigeait également le Laboratoire central de l'usine, prit la direction de la station expérimentale. Fort d'une vaste expérience en matière d'organisation de la recherche scientifique, il définit les principaux axes de recherche, tant théorique que pratique, et organisa le recrutement et la formation de jeunes spécialistes en dosimétrie, radiobiologie, radiochimie et autres sciences spécialisées. Il fut remplacé par N. A. Korneev, puis par E. A. Fedorov.
- Dans quelle direction les travaux ont-ils été menés chez ONIS ?
- Des informations étaient nécessaires sur les schémas de comportement des produits de fission à longue durée de vie dans l'environnement, notamment dans la chaîne : sol - plante agricole - animal d'élevage - produits d'élevage. Pour remédier à ces problèmes, plusieurs laboratoires ont été créés, et leurs employés, dans le cadre de recherches en laboratoire et sur le terrain, ont étudié les voies par lesquelles les radionucléides pénètrent dans les plantes agricoles, le bétail et la volaille, ont développé des méthodes de traitement des sols contaminés pour réduire la pénétration des radionucléides du sol dans les plantes, ainsi que des méthodes d'élevage et d'alimentation des animaux et de la volaille.
Ces méthodes ont été testées sur les champs agricoles de la station de production expérimentale, qui disposait d'environ 3 mille hectares de terres, d'une ferme d'élevage où étaient gardés des bovins, des porcs, des moutons, des canards et des poulets.
Les résultats des recherches théoriques et pratiques ont permis de restituer à l'économie nationale quarante mille hectares de terres agricoles auparavant aliénées, sur le territoire de la VURS, occupées par des lacs, des marais et des forêts, et la réserve radioactive de l'Oural oriental a été créée.
De mai 1986 à avril 1990, la station expérimentale a participé activement à la résolution des problèmes liés aux conséquences de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl.
Suite à l'effondrement de l'URSS, les financements ont été fortement réduits, entraînant la fermeture de la station. Les 87 employés restants ont été transférés au Laboratoire central de radioprotection, où ils poursuivent leurs travaux de surveillance de la radioactivité dans les zones situées à l'intérieur du périmètre du parc industriel de Maïak et mènent des recherches scientifiques au sein de la réserve naturelle.
- Ivan Grigorievitch, vous détenez le titre d'inventeur, qui ne vous a certainement pas été attribué par hasard dans l'ex-URSS. Vous possédez des certificats d'inventeur pour de nombreuses inventions. Par exemple, vous avez travaillé à la suite de l'accident de 1957 à l'Association de production Maïak
Les particules radioactives (aérosols) entraînées dans l'atmosphère se déposent à la surface de la Terre : les plus grosses retombent près de la source d'émission, tandis que les plus petites peuvent être transportées sur de longues distances. Au cours de leur déplacement, elles se combinent aux aérosols présents dans l'atmosphère et se déposent sur les arbres, l'herbe, le sol et l'eau. Elles pénètrent partout ! À l'automne 1957, des légumes-racines et des pommes de terre déjà stockés dans des caves ont été contaminés par des aérosols radioactifs. Sous l'effet du vent et de la pluie, les aérosols faiblement liés sont emportés des arbres, de l'herbe et du sol et peuvent être transportés au-delà de la zone contaminée. Ce fut effectivement le cas durant l'automne 1957 et le printemps 1958, marqués par l'absence de neige. Mais avec l'apparition du couvert végétal, le transfert a considérablement diminué et environ 90 % des radionucléides se sont concentrés dans la couche superficielle.
Ils décidèrent alors de labourer à nouveau 20 000 hectares de terres afin de mélanger la terre de surface contaminée à la couche arable (on pensait que cela réduirait l'absorption des radionucléides par les parties aériennes des plantes via leurs systèmes racinaires). Cependant, le labour conventionnel ne fit que localiser les radionucléides et n'eut aucun impact significatif sur la réduction de leur absorption par les parties aériennes des plantes cultivées.
Que faire ? À quelle profondeur faut-il placer la couche de terre contaminée pour que les racines ne l'atteignent pas ?
Lors d'expériences sur le terrain menées [...] sous la direction d'A. V. Marakushin et E. R. Ryabova, il a été établi que si un sol contaminé est placé dans l'horizon du sol sous-jacent à une profondeur de plus de 60 cm, alors l'afflux de radionucléides provenant de la couche contaminée diminuera de 2 à 5 fois.
Mais comment pouvons-nous retirer la couche de sol superficiellement contaminée et l'« enfouir » dans l'horizon souterrain à une profondeur suffisamment grande ?
J'ai alors proposé la conception d'une charrue qui déplace les horizons du sol, résolvant ainsi le problème.
- Dites-nous de quoi il était fait et comment il fonctionnait ?
Un corps principal était monté sur le châssis d'une charrue de plantation, avec un corps supplémentaire à gauche et à l'arrière. Le corps principal servait à créer un espace libre dans le sous-sol, tandis que le corps supplémentaire devait y déverser la terre contaminée.
Trente-cinq de ces charrues furent fabriquées. Fonctionnant en deux équipes en 1960 et 1961, elles décontaminèrent environ 8 000 hectares de terres (dont une partie des potagers privés du chef-lieu du district de Bagaryak, évitant ainsi l'expulsion de ses habitants), ainsi que des champs destinés à la production d'aliments pour le bétail privé et public, environ 1 000 hectares de terres appartenant à une station expérimentale et les potagers des habitants du village de Metlino. La charrue décontamina également environ 50 hectares de terres dans l'ancien village de Kazhakul, où l'on cultive encore aujourd'hui diverses plantes maraîchères respectant des normes strictes de radioprotection.
Une version améliorée de cette charrue a été utilisée dans les champs de la zone des trente kilomètres autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl. [...]