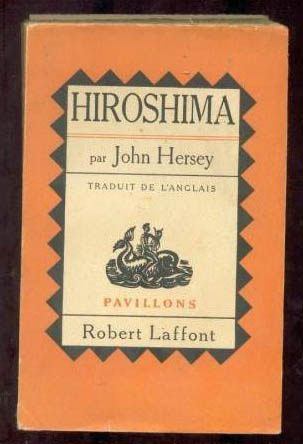
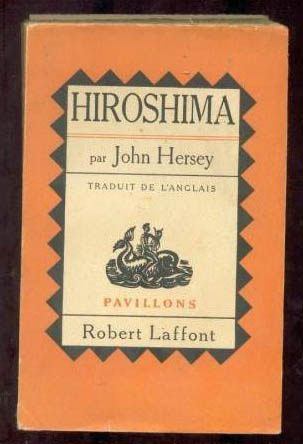
Extrait:
[Les photos, à part celles du
Révérend Tanimoto et du Père Kleinsorge ont
été rajoutées par Infonucléaire]
Le Révérend Tanimoto s'était
levé, ce matin-là, à cinq heures. Il était
seul dans le presbytère; depuis quelque temps, sa femme,
avec leur bébé d'un an, s'en allait tous les soirs
passer la nuit chez une amie, à Ushida, faubourg Nord.
De toutes les grandes villes japonaises, deux seulement, Kyoto
et Hiroshima, n'avaient pas reçu la visite en force de
B-san (ou de « Monsieur B ») comme
les Japonais, dans un mélange de respect et de familiarité
dans le malheur, appelaient les B-29 et M. Tanimoto, comme tous
ses voisins et amis, était presque malade d'angoisse. Il
avait entendu, non sans malaise, raconter en détail les
raids massifs sur Kuré, Iwanuki, Tokuyama, et autres cités
proches ; il était sûr que le tour de Hiroshima
ne saurait tarder. Il avait passé une mauvaise nuit, la
veille : il y avait eu plusieurs alertes. Depuis des semaines,
il ne se passait guère de nuit sans que les sirènes
retentissent sur Hiroshima ; car, à l'époque,
les B-29 se servaient du lac Biwa, au Nord-Est de la ville, comme
de lieu de rendez-vous aérien, et quelle que fût
la cité que les Américains projetassent de frapper,
les vagues de superforteresses déferlaient et franchissaient
la côte non loin de Hiroshima. La fréquence des alertes
et l'obstination que mettait « M. B... »
à ne pas toucher à Hiroshima, avaient porté
à son comble la nervosité des habitants ; le
bruit courait que les Américains réservaient à
la ville une attention particulière.  M.
Tanimoto est un, homme de petite taille, également prompt
à discourir, à rire et à pleurer. Une raie
partage par le milieu ses cheveux noirs et plutôt longs ;
la saillie de l'os frontal, immédiatement au-dessus des
sourcils, la brièveté de la moustache, la petitesse
de la bouche et du menton lui donnent un air vieux-jeune, un air
d'adolescent plein de sagesse, et d'ardente faiblesse. Ses mouvements
sont nerveux et vifs, mais empreints d'une réserve qui
suggère la prudence avisée. Et c'est un fait qu'il
témoigna précisément de ces qualités
au cours des inquiètes journées qui précédèrent
l'explosion de la bombe. Non seulement M. Tanimoto envoyait sa
femme passer les nuits à Ushida, mais il avait transporté
tout ce qu'il avait pu, de sa chapelle, sise dans le quartier
surpeuplé de Nagaragawa, dans la demeure d'un fabricant
de rayonne de Koï, à quelque trois kilomètres
et demi du centre. Ce fabricant de rayonne, un M. Matsui, avait
ouvert cette propriété, vaste et jusqu'alors inoccupée,
à un grand nombre de ses amis et connaissances,
pour leur permettre d'évacuer, à distance convenable
de l'aire probable des bombardements, les choses qu'ils désiraient
mettre à l'abri. M. Tanimoto n'avait eu aucun mal à
déménager chaises, hymnaires, Bibles, ornements
sacrés et registres de paroisse, en s'attelant lui-même
à la charrette à bras ; mais le buffet d'orgue
et le piano droit requéraient une aide. Un de ses amis,
du nom de Matsuo, lui avait prêté la main, la veille,
pour charrier le piano jusqu'à Koï ; en échange,
il avait promis d'aider ce jour-là M. Matsuo à trimbaler
le mobilier d'une de ses filles. Voilà pourquoi il s'était
levé de si bonne heure.
M.
Tanimoto est un, homme de petite taille, également prompt
à discourir, à rire et à pleurer. Une raie
partage par le milieu ses cheveux noirs et plutôt longs ;
la saillie de l'os frontal, immédiatement au-dessus des
sourcils, la brièveté de la moustache, la petitesse
de la bouche et du menton lui donnent un air vieux-jeune, un air
d'adolescent plein de sagesse, et d'ardente faiblesse. Ses mouvements
sont nerveux et vifs, mais empreints d'une réserve qui
suggère la prudence avisée. Et c'est un fait qu'il
témoigna précisément de ces qualités
au cours des inquiètes journées qui précédèrent
l'explosion de la bombe. Non seulement M. Tanimoto envoyait sa
femme passer les nuits à Ushida, mais il avait transporté
tout ce qu'il avait pu, de sa chapelle, sise dans le quartier
surpeuplé de Nagaragawa, dans la demeure d'un fabricant
de rayonne de Koï, à quelque trois kilomètres
et demi du centre. Ce fabricant de rayonne, un M. Matsui, avait
ouvert cette propriété, vaste et jusqu'alors inoccupée,
à un grand nombre de ses amis et connaissances,
pour leur permettre d'évacuer, à distance convenable
de l'aire probable des bombardements, les choses qu'ils désiraient
mettre à l'abri. M. Tanimoto n'avait eu aucun mal à
déménager chaises, hymnaires, Bibles, ornements
sacrés et registres de paroisse, en s'attelant lui-même
à la charrette à bras ; mais le buffet d'orgue
et le piano droit requéraient une aide. Un de ses amis,
du nom de Matsuo, lui avait prêté la main, la veille,
pour charrier le piano jusqu'à Koï ; en échange,
il avait promis d'aider ce jour-là M. Matsuo à trimbaler
le mobilier d'une de ses filles. Voilà pourquoi il s'était
levé de si bonne heure.
M. Tanimoto prépara lui-même son petit déjeuner.
Il se sentait affreusement fatigué. La dépense de
force que lui avait coûtée, la veille, le déménagement
du piano, l'insomnie de la nuit, des semaines de tracas et d'alimentation
déréglée, les soucis de sa paroisse, tout
concourait à lui donner l'impression de n'être guère
à la hauteur des tâches de la journée. A cela
s'ajoutait encore que M. Tanimoto avait fait ses études
en théologie à Emory College, Atlanta, Etat de Géorgie ;
que ses diplômes dataient de 1940 ; qu'il parlait un
excellent anglais, s'habillait à l'américaine, était
resté en correspondance avec de nombreux amis américains
jusqu'aux derniers jours de la paix ; et que, au milieu d'un
peuple en proie à la peur obsédante de la police
- hantise qu'il n'était peut-être pas sans éprouver
lui-même - il sentait croître en lui un malaise incessant.
De fait, la police l'avait interrogé plusieurs fois, et
il y avait à peine quelques jours, il avait entendu dire
qu'un certain M. Tanaka, homme de sa connaissance, très
influent, directeur à la retraite de la compagnie de navigation
Toyo Kisen Kaisha, antichrétien notoire, célèbre
à Hiroshima pour sa philanthropie tapageuse et non moins
fameux pour sa réputation de tyrannie, avait raconté
à des gens qu'il fallait se méfier de Tanimoto.
En compensation de quoi, et pour témoigner publiquement
de son patriotisme, M. Tanimoto avait assumé la présidence
du tonarigumi (ou Association de Quartier), et à
ses autres devoirs et soucis cette position avait ajouté
le soin d'organiser la défense passive pour une vingtaine
de familles.
Six heures du matin n'étaient pas sonnées que M.
Tanimoto se mettait en chemin pour la maison de M. Matsuo. Il
arriva chez ce dernier pour trouver que c'était un tansu,
lourde commode japonaise, pleine de vêtements et d'objets
de ménage, qu'il leur faudrait déménager.
Les deux hommes s'attelèrent à la charrette et partirent.
La matinée était parfaitement claire et si chaude
qu'elle promettait une journée pénible. Ils cheminaient
depuis quelques minutes, lorsque la sirène retentit, signal
continu, d'une minute, avertissant la population que des avions
approchaient mais n'indiquant aucun danger sérieux, et
précis pour elle, puisqu'il n'était pas de matin
qu'on ne l'entendît : vers cette heure-là, régulièrement,
un appareil de reconnaissance météorologique américain
venait survoler la côte. Les deux hommes tiraient et poussaient
la charrette à travers les rues de la ville. Hiroshima était bâtie en éventail,
en majeure partie sur la demi-douzaine d'îles que forment
les sept branches de l'estuaire en delta de la rivière
Ota ; les principaux quartiers d'affaires et de résidence
s'étendant sur un peu plus de dix kilomètres carrés
au centre de la cité, renfermaient les trois quarts de
la population, que l'exécution de plusieurs plans d'évacuation
avait réduite, de son chiffre maximum de temps de guerre
- 380 000 - à quelque 245 000. Usines, autres
quartiers résidentiels ou faubourgs traçaient une
frange compacte autour de la ville. Au Sud, couraient les docks,
un aérodrome et la mer Intérieure, comme cloutée
d'îles. Une crête de montagnes cerne les trois autres
côtés du delta. M. Tanimoto et M. Matsuo, ayant traversé
successivement le centre et ses rues commerçantes, déjà
plein de monde, puis deux bras du delta, gravissaient maintenant
les rues en pente de Koï, en direction des quartiers extérieurs
et des collines naissantes. Au moment où ils attaquaient
une côte, dans une vallée à l'écart
de la zone de fort peuplement, la fin d'alerte sonna. (Les opérateurs
japonais de radar, ne détectant que trois avions, supposèrent
qu'il s'agissait d'une reconnaissance.) Pousser la charrette dans
la côte, pour arriver à la maison du fabricant de
rayonne, était chose fatigante, et les deux hommes, après
s'être engagés avec leur chargement dans l'allée
principale et avoir atteint le perron firent halte pour souffler
un peu. Entre la ville et eux, se dressait une aile de la maison.
Comme la plupart des demeures, dans cette région du Japon,
la maison consistait en une charpente en bois et en murs de bois
aussi, soutenant un lourd toit de tuiles. Le vestibule d'entrée,
bourré de ballots de literie et de vêtements, avait
l'air d'une grotte fraîche comblée de coussins. En
face de la maison, à droite de la porte d'entrée,
il y avait un grand jardin en rocaille, fort prétentieux.
Pas le moindre bruit d'avion. La matinée était paisible
et tranquille ; le lieu, plein d'agréable fraîcheur.
Puis une formidable et fulgurante lueur déchira le ciel.
M. Tanimoto se souvient distinctement qu'elle se traça
d'Est en Ouest, de la ville vers les collines. On eût dit
une nappe de soleil. M. Matsuo et lui eurent une réaction
de terreur, et le temps de réagir (car ils se trouvaient
à 3.300 mètres environ du centre de l'explosion).
M. Matsuo franchit d'un bond le perron et le seuil de la maison,
pour plonger parmi l'amas de literie et s'y ensevelir littéralement.
M. Tanimoto fit quatre ou cinq pas et se jeta entre deux gros
rocs du jardin. Il s'aplatit de toutes ses forces sur le ventre,
contre l'un d'eux. Face à la pierre, il ne vit rien de
ce qui arriva. Il sentit une soudaine pression, puis une pluie
de menus éclats, de morceaux de bois et de fragments de
tuiles. Il n'entendit nul fracas. (Presque personne, à
Hiroshima, ne se souvient d'avoir entendu un bruit de bombe. Seul,
un pêcheur à bord de son sampan, sur la mer intérieure
à proximité de Tsuzu, et chez qui vivaient la belle-mère
et la belle-soeur de M. Tanimoto, vit la lueur et entendit une
formidable explosion ; il était à près
de trente-trois kilomètres de Hiroshima, mais le tonnerre
fut plus fort que lors du bombardement d'Iwakuni par les B-29,
et Iwakuni n'était qu'à cinq kilomètres de
là.)
Quand il osa lever la tête, M. Tanimoto vit que la maison
du fabricant de rayonne s'était effondrée. Il crut
qu'une bombe était tombée droit dessus. De tels
nuages de poussière flottaient dans l'air qu'un crépuscule
semblait être descendu sur le quartier. Cédant à
la panique, et oubliant sur le moment M. Matsuo enseveli sous
les ruines, M. Tanimoto se précipita dans la rue. Il remarqua,
tout en courant, que le mur en béton de la propriété
s'était écroulé vers la maison plutôt
que vers le dehors. Dans la rue, la première chose qui
le frappa, ce fut une escouade de soldats employés à
creuser une galerie à flanc de colline, en face (un de
ces milliers d'abris secrets où les Japonais, apparemment,
avaient l'intention de se retrancher pour résister à
l'invasion, colline par colline, vie pour vie) de ce terrier,
où ils auraient dû être en sécurité,
les soldats sortaient, tête, poitrine, dos en sang ;
muets, abrutis et titubants.
Sous l'effet de ce que l'on eût dit être un phénomène
local - un nuage de poussière en suspens - le jour s'assombrit
de plus en plus. [...]
II L'incendie
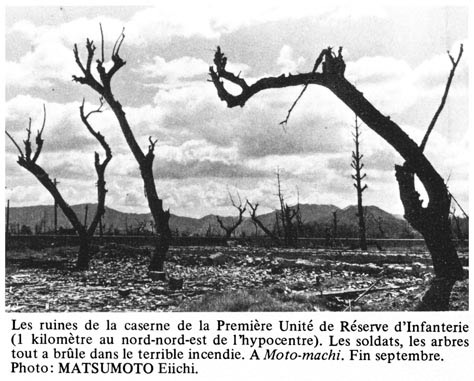 Aussitot après l'explosion,
le Révérend Kiyoshi Tanimoto, que nous avons laissé
se précipitant comme un fou hors de la propriété
de M. Matsui et regardant avec stupeur des soldats couverts de
sang déboucher de la galerie souterraine qu'ils étaient
occupés à creuser, donna tous ses soins apitoyés
à une vieille dame qui marchait droit devant elle, hébétée,
se tenant la tête de la main gauche et, de la droite, soutenant
un petit garçon de trois ou quatre ans qu'elle portait
sur son dos, tout en criant : « Je suis blessée !
Je suis blessée ! Je suis blessée ! »
M. Tanimoto transféra l'enfant du dos de la femme sur le
sien, puis, la prenant par la main, la conduisit jusqu'au bas
de la rue qu'obscurcissait ce que l'on eût dit être
une colonne de poussière bien localisée. Ils arrivèrent
à une école primaire, non loin de là, désignée
auparavant pour servir d'hôpital temporaire en cas de nécessité.
L'attention pleine de sollicitude qu'il avait portée à
la vieille femme aida M. Tanimoto à se débarrasser
sur-le-champ de sa terreur. Parvenu à l'école, il
fut grandement surpris de s'apercevoir que le sol était
couvert de débris de verre et que cinquante à soixante
blessés attendaient déjà d'être pansés.
Il se dit que, bien que la fin d'alerte eût sonné
et qu'il n'eût pas entendu d'avions, plusieurs bombes avaient
dû tomber. Il se souvint d'un monticule, dans le jardin
du fabricant de rayonne, d'où l'on avait vue sur l'ensemble
de Koï - et de Hiroshima, pour autant - et il revint en courant
à la propriété.
Aussitot après l'explosion,
le Révérend Kiyoshi Tanimoto, que nous avons laissé
se précipitant comme un fou hors de la propriété
de M. Matsui et regardant avec stupeur des soldats couverts de
sang déboucher de la galerie souterraine qu'ils étaient
occupés à creuser, donna tous ses soins apitoyés
à une vieille dame qui marchait droit devant elle, hébétée,
se tenant la tête de la main gauche et, de la droite, soutenant
un petit garçon de trois ou quatre ans qu'elle portait
sur son dos, tout en criant : « Je suis blessée !
Je suis blessée ! Je suis blessée ! »
M. Tanimoto transféra l'enfant du dos de la femme sur le
sien, puis, la prenant par la main, la conduisit jusqu'au bas
de la rue qu'obscurcissait ce que l'on eût dit être
une colonne de poussière bien localisée. Ils arrivèrent
à une école primaire, non loin de là, désignée
auparavant pour servir d'hôpital temporaire en cas de nécessité.
L'attention pleine de sollicitude qu'il avait portée à
la vieille femme aida M. Tanimoto à se débarrasser
sur-le-champ de sa terreur. Parvenu à l'école, il
fut grandement surpris de s'apercevoir que le sol était
couvert de débris de verre et que cinquante à soixante
blessés attendaient déjà d'être pansés.
Il se dit que, bien que la fin d'alerte eût sonné
et qu'il n'eût pas entendu d'avions, plusieurs bombes avaient
dû tomber. Il se souvint d'un monticule, dans le jardin
du fabricant de rayonne, d'où l'on avait vue sur l'ensemble
de Koï - et de Hiroshima, pour autant - et il revint en courant
à la propriété.
De ce monticule, M. Tanimoto découvrit un panorama stupéfiant.
Ce n'était pas seulement d'un petit coin de Koï, comme
il s'y était attendu - c'était de tout ce qu'il
apercevait de Hiroshima, à travers le nuage dont l'air
était obscurci, que montait une épaisse et, épouvantable
colonne d'atmosphère empoisonnée. De massives gerbes
de fumée, proches ou lointaines, s'élevaient déjà,
trouant la nappe immense de poussière. Il se demanda comment
tant de dégâts, sur une telle surface, avaient pu
naître d'un ciel silencieux ; ne se fût-il agi
que de quelques avions, volant à haute altitude, on n'eût
pas manqué de les entendre. Non loin, des maisons brûlaient
et lorsque d'énormes gouttes d'eau, grosses comme des billes,
se mirent à tomber, il eut comme une idée qu'elles
devaient provenir des lances des pompiers luttant contre le feu.
(En fait, c'étaient des
gouttes résultant de la condensation de l'atmosphère,
tombant de la tumultueuse colonne de fumée, d'air chaud
et de matière désintégrée, qui montait
déjà à des kilomètres dans le ciel
au-dessus de Hiroshima.)
M. Tanimoto se détourna de ce spectacle en entendant M.
Matsuo l'appeler et lui demander s'il était indemne. M.
Matsuo, à l'intérieur de la maison effondrée,
avait bénéficié de la moelleuse protection
de la literie accumulée dans le hall d'entrée, d'où
il avait réussi ensuite à se dépêtrer.
M. Tanimoto répondit à peine à ces appels.
Pensant à sa femme, à son bébé, à
sa chapelle, à son foyer, à ses paroissiens - là-bas,
tous noyés dans ces affreuses ténèbres -
une fois de plus, il s'était remis à courir, en
proie à la panique, vers la ville. [...]
M. Tanimoto, terrifié à la pensée de sa famille et de sa chapelle, s'était d'abord élancé, dans l'idée de les rejoindre en prenant au plus court, par la grand'route de Koï.
 Vers
le 12 août. Photo: KAWAHARA Yotsugi.
Vers
le 12 août. Photo: KAWAHARA Yotsugi.
Une vue des environs de Kami-Nobori-cho. Le bâtiment
au centre est l'église Nagarekawa de Hiroshima,
du Conseil national des Eglises du Japon, à 900 mètres
est-nord-est de l'hypocentre. Le bâtiment qui se trouve
derrière est ce qui reste de l'Office de la radiodiffusion
de Hiroshima.
Il était le seul à s'enfoncer
dans la ville ; les centaines et les centaines de gens qu'il
croisait, fuyaient et il n'était pas un des fugitifs qui
ne semblât avoir été atteint de quelque manière.
Certains avaient les sourcils littéralement calcinés
et la peau pendait de leur visage et de leurs mains. D'autres,
sous l'effet de la souffrance, avançaient les bras levés,
comme portant quelque chose à deux mains. Il en était
qui vomissaient en marchant. Beaucoup étaient nus ou n'étaient
plus vêtus que de lambeaux de vêtements. Sur certains
corps ainsi dénudés, les brûlures s'étaient
inscrites en motifs dessinant les épaulettes d'un gilet
de dessous, ou des bretelles ; et sur la peau de certaines
femmes (étant donné que le blanc repoussait la chaleur
dégagée par la bombe, tandis que le noir l'absorbait
et servait de conducteur), les fleurs imprimées sur les
kimonos. Beaucoup aussi, blessés eux-mêmes, soutenaient
des parents plus grièvement atteints. Presque tous avançaient
la tête basse, regardant droit devant eux, se taisant et
montrant des visages dénués d'expression.
Après avoir traversé le pont de Koï et le pont
de Kannon, sans cesser un instant de courir, M. Tanimoto s'aperçut,
à mesure qu'il s'approchait du centre, que toutes les maisons
étaient comme écrasées et que beaucoup d'entre
elles brûlaient. Les arbres étaient à nu,
les troncs carbonisés. Il tenta en plusieurs points de
pénétrer parmi les ruines, mais chaque fois fut
arrêté par les flammes. Sous les restes de quantité
de maisons, les gens appelaient au secours, mais personne ne s'occupait,
d'eux ; en règle générale, ce jour-là,
les survivants ne se portèrent à l'aide que de parents
ou de voisins immédiats, car il leur était impossible
d'embrasser par l'esprit, voire même simplement de tolérer,
l'idée d'un cercle de souffrances plus étendu.
Les blessés passaient en boitant devant ces cris ;
et M. Tanimoto, lui, passait en courant. En tant que chrétien,
il se sentait rempli de compassion pour les malheureux pris au
piège ; en tant que Japonais, il succombait sous la
honte d'être intact dans son corps et il priait tout en
courant : « Dieu vienne en aide aux malheureux
et les arrache à ces flammes ! »
 Il s'était dit qu'en prenant
sur la gauche, il contournerait l'incendie. Il revint, toujours
courant, au pont de Kannon et suivit sur une certaine distance
le bord de la rivière. Il tenta de s'enfoncer dans plusieurs
rues transversales, mais les trouva toutes bloquées ;
il finit donc par tourner loin sur sa gauche et courut jusqu'à
Yokogawa, gare sur une ligne de chemin de fer qui faisait le tour
de la ville en un large demi-cercle et il suivit la voie ferrée
jusqu'à ce qu'il tombât sur un train en flammes.
L'étendue du désastre l'avait, à ce point
de sa course, si impressionné, qu'il remonta en courant
vers le nord, jusqu'à Gion, à plus de trois kilomètres
de là (Gion étant un faubourg situé au pied
des collines). Tout le long du chemin, il dépassa des gens
affreusement brûlés et déchirés et,
tourmenté par son remords patriotique, il se tournait à
droite et à gauche, sans s'arrêter, disant à
tel ou tel d'entre eux : « Pardonnez-moi de ne
pas porter ma part de votre fardeau ». Près
de Gion, il commença à rencontrer des gens de la
campagne qui faisaient route vers la ville pour porter secours.
L'apercevant, ils s'écrièrent . « Regardez !
En voici un qui n'est pas blessé ! » A
Gion, il prit en direction de la rive droite de la rivière
principale, l'Ota, et courut jusqu'au bord de l'eau, où
il retrouva l'incendie. Il n'y avait pas de flammes sur l'autre
rive, ce qui fit que, dépouillant sa chemise et ses chaussures,
il plongea dans l'eau. Parvenu au milieu de la rivière,
où le courant était assez fort, l'épuisement
et la peur finirent par avoir le dessus - il avait fait en courant
une douzaine de kilomètres - et perdant tout ressort, il
sentit que les eaux l'entraînaient. Il pria : « Je
vous supplie, mon Dieu, aidez-moi à toucher l'autre bord.
Ce serait trop bête de périr noyé quand je
suis le seul à ne pas être blessé. »
Il réussit à faire encore quelques brasses et prit
pied sur une langue de sable, en aval.
Il s'était dit qu'en prenant
sur la gauche, il contournerait l'incendie. Il revint, toujours
courant, au pont de Kannon et suivit sur une certaine distance
le bord de la rivière. Il tenta de s'enfoncer dans plusieurs
rues transversales, mais les trouva toutes bloquées ;
il finit donc par tourner loin sur sa gauche et courut jusqu'à
Yokogawa, gare sur une ligne de chemin de fer qui faisait le tour
de la ville en un large demi-cercle et il suivit la voie ferrée
jusqu'à ce qu'il tombât sur un train en flammes.
L'étendue du désastre l'avait, à ce point
de sa course, si impressionné, qu'il remonta en courant
vers le nord, jusqu'à Gion, à plus de trois kilomètres
de là (Gion étant un faubourg situé au pied
des collines). Tout le long du chemin, il dépassa des gens
affreusement brûlés et déchirés et,
tourmenté par son remords patriotique, il se tournait à
droite et à gauche, sans s'arrêter, disant à
tel ou tel d'entre eux : « Pardonnez-moi de ne
pas porter ma part de votre fardeau ». Près
de Gion, il commença à rencontrer des gens de la
campagne qui faisaient route vers la ville pour porter secours.
L'apercevant, ils s'écrièrent . « Regardez !
En voici un qui n'est pas blessé ! » A
Gion, il prit en direction de la rive droite de la rivière
principale, l'Ota, et courut jusqu'au bord de l'eau, où
il retrouva l'incendie. Il n'y avait pas de flammes sur l'autre
rive, ce qui fit que, dépouillant sa chemise et ses chaussures,
il plongea dans l'eau. Parvenu au milieu de la rivière,
où le courant était assez fort, l'épuisement
et la peur finirent par avoir le dessus - il avait fait en courant
une douzaine de kilomètres - et perdant tout ressort, il
sentit que les eaux l'entraînaient. Il pria : « Je
vous supplie, mon Dieu, aidez-moi à toucher l'autre bord.
Ce serait trop bête de périr noyé quand je
suis le seul à ne pas être blessé. »
Il réussit à faire encore quelques brasses et prit
pied sur une langue de sable, en aval.
Il escalada la berge et la longea en courant jusqu'au moment où,
près d'un temple shintoïste, il se heurta encore à
l'incendie. Comme il tournait sur la gauche, dans l'espoir de
trouver une issue, il rencontra, par une chance incroyable, sa
femme. Elle portait dans ses bras leur bébé. M.
Tanimoto était parvenu à un tel degré d'épuisement
émotif, que plus rien ne pouvait le surprendre. Il n'embrassa
pas sa femme ; il se borna à dire : « Oh !
vous êtes sauve ! » Elle lui raconta qu'elle
était arrivée chez eux, après avoir passé
la nuit à Ushida, juste à temps pour l'explosion,
et qu'elle avait été ensevelie sous le presbytère
avec l'enfant dans ses bras. Elle lui dit comment les décombres
avaient pesé sur elle, comment le bébé avait
crié. Elle avait vu une faible crevasse de lumière
et, en tendant la main, elle avait réussi à agrandir
le trou, petit à petit. Au bout d'une demi-heure, environ,
elle avait entendu et reconnu le crépitement du bois qui
brûlait. Enfin, l'ouverture avait été assez
grande pour qu'elle parvînt à y faire passer l'enfant,
en le poussant, puis à se hisser en rampant à son
tour. Elle ajouta qu'elle retournait maintenant à Ushida.
M. Tanimoto lui répondit qu'il voulait voir où en
était sa chapelle et s'occuper des gens de son Association
de Quartier. Ils se séparèrent aussi fortuitement,
aussi hébétés, qu'ils s'étaient retrouvés.
Le chemin qu'avait pris M. Tanimoto pour contourner l'incendie
le fit traverser le Champ de Manoeuvre de l'Est qui, zone d'évacuation,
était à présent le théâtre d'une
horrible parade : blessés ensanglantés et brûlés
par files entières. Les brûlés gémissaient :
« Mizu, mizu ! A boire, à boire ! »
M. Tanimoto, ayant trouvé un baquet dans une rue proche
et repéré un robinet qui fonctionnait encore dans
la carcasse écrabouillée d'une maison, entreprit
d'apporter de l'eau à ces inconnus qui souffraient. Lorsqu'il
eut donné à boire à une trentaine d'entre
eux, il se rendit compte - qu'il perdait trop de temps. « Excusez-moi,
dit-il d'une voix forte à ceux qui, tout près, tendaient
les mains vers lui et criaient leur soif, nombreux sont ceux qui
attendent mes soins. » Puis il s'en fut en courant.
Il retourna au bord de la rivière, son baquet à
la main et sauta sur un banc de sable. Là, il vit des centaines
de gens si mal en point, qu'il leur était impossible de
fuir plus loin la cité en flammes. Quand ces gens aperçurent
un homme valide et indemne, la même plainte recommença:
« Mizu, mizu, mizu ».
M. Tanimoto n'y put résister ; il alla chercher
de l'eau à la rivière, qu'il leur distribua - erreur
de sa part, l'eau étant saumâtre, du fait de la marée.
Deux ou trois petits bateaux traversaient la rivière, transportant
les blessés du parc Asano. Quand l'un d'eux accosta au
banc de sable, M. Tanimoto réitéra de la même
voix forte son petit discours d'excuses et sauta à bord.
Il se trouva ainsi atteindre le parc. Là, parmi les broussailles,
il retrouva certains des gens de son Association de Quartier,
dont il avait la responsabilité et qui s'étaient
rendus en cet endroit conformément à ses instructions
précédentes ;  il
retrouva aussi de nombreuses connaissances, entre autres le Père
Kleinsorge et les autres membres de la communauté catholique.
Mais Fukai, qui était un de ses amis intimes, manquait.
« Où est Fukai ? » demanda-t-il.
« Il n'a pas voulu venir avec nous, répondit
le Père Kleinsorge. Il s'est sauvé et il est retourné
là-bas. » [...]
il
retrouva aussi de nombreuses connaissances, entre autres le Père
Kleinsorge et les autres membres de la communauté catholique.
Mais Fukai, qui était un de ses amis intimes, manquait.
« Où est Fukai ? » demanda-t-il.
« Il n'a pas voulu venir avec nous, répondit
le Père Kleinsorge. Il s'est sauvé et il est retourné
là-bas. » [...]
Quand M. Tanimoto, son baquet toujours à la main, arriva
au parc, celui-ci était encombré d'une grande foule,
et il était bien difficile de distinguer les morts des
vivants, car la plupart des gens, couchés, ne bougeaient
pas, les yeux grands ouverts. Pour le Père Kleinsorge,
homme d'Occident, le silence dans ces bosquets au bord de la rivière,
où des centaines d'êtres atrocement blessés
confondaient leurs souffrances, fut l'un des traits les plus effroyables,
les plus épouvantables de son expérience. Ceux qui
avaient mal, se taisaient ; personne ne pleurait, ou ne criait
de douleur encore moins ; pas une plainte ; de tous
ceux qui succombèrent, pas un seul ne mourut bruyamment ;
les enfants mêmes étaient muets ; très
peu de gens parlaient, simplement. Et quand le Père Kleinsorge
donna à boire à certains blessés dont le
visage disparaissait presque sous les brûlures, ils burent
chacun à leur tour, puis se soulevant légèrement,
lui firent une petite révérence pour le remercier.
M. Tanimoto salua les prêtres, puis regarda autour de lui,
en quête de visages amis. Il reconnut Mme Matsumoto, la
femme du directeur de l'école méthodiste, et lui
demanda si elle avait soif. Elle lui dit que oui ; il alla
donc lui chercher de l'eau dans son baquet à l'un des petits
lacs de la rocaille du parc. Puis il décida d'essayer de
pousser jusqu'à sa chapelle. Suivant le chemin que les
prêtres avaient parcouru dans leur fuite devant l'incendie,
il s'engagea dans Nobori-cho ; il n'alla pas loin :
l'incendie faisait tellement rage dans les rues, qu'il lui fallut
rebrousser chemin. Il descendit jusqu'à la berge et se
mit en quête d'une embarcation qui lui permit de transporter
de l'autre côté de la rivière certains des
blessés les plus graves, de façon à les éloigner
du parc Asano et du feu qui gagnait. Il tomba bientôt sur
un bateau de plaisance, à fond plat et de bonne taille,
échoué sur la rive ; mais à l'intérieur
et autour de la barque, un spectacle horrible s'offrit à
ses yeux : cinq cadavres d'hommes, presque nus, terriblement
brûlés et qui avaient dû expirer là,
plus ou moins du même coup, car leurs attitudes suggéraient
qu'ils s'étaient employés ensemble à tenter
de mettre le bateau à flots. M. Tanimoto enleva les cadavres
de la barque, et ce, faisant, il éprouva tant d'horreur
à déranger ces morts - à les empêcher,
se dit-il, sur le moment, de s'élancer avec leur embarcation
pour leur dernier voyage - qu'il dit à voix haute :
« Pardonnez-moi de prendre ce bateau. J'en ai absolument
besoin pour d'autres, qui sont en, vie. » La barque
était pesante, mais il parvint tout de même à
la pousser dans l'eau. Les rames manquaient ; tout ce qu'il
put trouver pour en tenir lieu, ce fut une grosse perche de bambou.
Il remonta péniblement le courant jusqu'à la partie
la plus encombrée du parc et entreprit de passer les blessés.
Il arrivait à les entasser par dix ou douze à chaque
passage ; mais la rivière étant trop profonde
en son milieu pour qu'il pût naviguer à la perche,
il lui fallait pagayer avec son bambou ; ce qui faisait que
chaque voyage lui prenait beaucoup de temps. Il peina plusieurs
heures de la sorte.
Au début de l'après-midi, le feu gagna les bosquets
du parc Asana. Le premier indice qu'en eut M. Tanimoto, ce fut
quand, au retour d'un de ses voyages de passeur, il vit qu'un
grand nombre de gens s'étaient rapprochés de la
rivière. En accostant, il alla se rendre compte sur place,
et quand il vit les flammes, il cria : « Que tous
les hommes jeunes et valides me suivent ! » Le
Père Kleinsorge transporta le Père Schiffer et le
Père La Salle tout au bord de l'eau, et, après avoir
demandé aux gens qui se trouvaient là de les transférer
sur l'autre rive si l'incendie venait trop près, se joignit
aux volontaires de M. Tanimoto. Ce dernier dépêcha
certains de ses hommes à la recherche de seaux et de baquets,
et dit aux autres de battre les fourrés qui brûlaient,
de leurs vêtements. Quand seaux et baquets furent là,
il organisa la chaîne, à partir de l'un des lacs
de la rocaille. Ses gens luttèrent contre le feu durant
plus de deux heures, et petit à petit eurent le dessus.
Pendant que les hommes de M. Tanimoto s'employaient de la sorte,
la foule effrayée se pressait de plus en plus vers la rivière ;
finalement, la masse en panique refoula certains des malheureux
qui se trouvaient sur le bord jusque dans l'eau. Parmi ceux qui
furent ainsi contraints d'entrer dans la rivière et s'y
noyèrent, se trouvèrent Mm Matsumoto, de l'école
méthodiste, et sa fille.
Quand le Père Kleinsorge revint, après avoir combattu
le feu, il trouva que le Père Schiffer perdait toujours
du sang et était affreusement pâle. Des Japonais
debout autour de lui le regardaient sans mot dire. Le Père
Schiffer murmura à son collègue dans un souffle :
« Je ne vaux pas mieux que si j'étais mort.
- Pas encore, » dit le Père Kleinsorge. Il avait
pris avec lui la musette de pansements du docteur Fujii, et il
avait remarqué, dans la foule, le docteur Kanda ;
il alla trouver ce dernier et lui demanda de bien vouloir soigner
les coupures du Père Schiffer. Le docteur Kanda avait vu,
parmi les décombres de sa clinique, sa femme et sa fille,
mortes ; il était assis la tête entre les mains.
« Je ne suis bon à rien, » dit-il.
Le Père Kleinsorge renforça le pansement autour
de la tête du Père Schiffer, l'aida à gagner
un endroit plus élevé et l'installa de façon
qu'il eût la tête haute ; bientôt l'hémorragie
diminua.
Ce fut environ à ce moment-là, qu'on entendit le
bruit de moteur d'avions qui approchaient. Quelqu'un dans la foule,
non loin de la famille Nakamura, cria « Les voilà
qui reviennent nous punir encore ! » Un boulanger,
du nom de Nakashima, se dressa et commanda : « Tous
ceux qui portent du blanc, ôtez-le ! » Mme
Nakamura ôta les blouses de ses enfants, ouvrit son parapluie
et fit se rassembler sa petite famille sous lui. Un grand nombre
de gens, y compris des brûlés graves, se traînèrent
en rampant parmi les buissons où ils restèrent jusqu'à
ce que le ronronnement - il s'agissait évidemment d'une
reconnaissance, météorologique ou autre - se fût
éteint.
La pluie commença à tomber. Mme Nakamura garda ses
enfants à l'abri du parapluie. Les gouttes devinrent d'une
grosseur anormale et quelqu'un cria : « Les Américains
nous aspergent de pétrole. Ils vont nous mettre le feu ! »
(Ce cri de terreur s'inspirait d'une des théories que l'on
se chuchotait de groupe en groupe dans le parc, sur l'étendue
du sinistre, savoir : qu'un seul avion, survolant la ville,
avait pulvérisé de l'essence et, de façon
ou d'autre, y avait mis le feu d'un seul coup, en une seconde.)
Mais les gouttes étaient évidemment de l'eau, et
au fur et à mesure qu'elles tombaient, le vent se fit de
plus en plus violent ; puis soudain - probablement par suite
de la prodigieuse convection provoquée par la ville en
flammes - un cyclone s'abattit sur le parc. D'énormes arbres
s'écrasèrent ; les plus petits étaient
déracinés et volaient dans les airs. Plus haut dans
le ciel, un invraisemblable cortège d'objets plats tournoyait
dans la trompe du cyclone : ferrailles, débris de
tôle, papiers, portes, morceaux de nattes. Le Père
Kleinsorge couvrit d'un lambeau d'étoffe les yeux du Père
Schiffer, de peur que le blessé, affaibli, n'allât
s'imaginer qu'il devenait fou. La tempête balaya Mme Murata,
la femme de charge de la mission, qui était assise tout
près de la rivière, et la fit rouler en bas de la
berge, la précipitant sur un endroit rocheux où
l'eau était peu profonde et d'où elle sortit, les
pieds nus en sang. Le tourbillon se déplaça ensuite
vers le milieu de la rivière, où il pompa une colonne
d'eau et finit par s'épuiser.
Après le cyclone, M. Tanimoto recommença à
panser des blessés et le Père Kleinsorge demanda
à l'étudiant en théologie de traverser la
rivière et d'aller jusqu'au noviciat des jésuites,
à Nagatsuka, soit environ cinq kilomètres du centre
de la ville, afin. que les prêtres qui étaient là
vinssent avec du secours chercher les Pères Schiffer et
La Salle. L'étudiant prit place sur la barque de M. Tanimoto
et s'éloigna en même temps que ce dernier. Le Père
Kleinsorge demanda à Mme Nakamura si elle n'aimerait pas
partir pour Nagatsuka avec les prêtres, quand ils arriveraient.
Elle lui dit qu'elle avait avec elle des bagages, que ses enfants
étaient malades - ils vomissaient encore de temps à
autre, de même qu'elle, aussi bien - et qu'elle avait peur,
en conséquence, de se mettre en chemin. Le religieux lui
dit qu'il pensait que les prêtres du noviciat pourraient
revenir la chercher le lendemain, avec une charrette à
bras.
Tard dans l'après-midi, alors qu'il prenait pied sur la
berge pour s'arrêter quelque temps, M. Tanimoto, à
l'énergie et à l'esprit d'initiative duquel nombre
de gens avaient fini par s'en remettre, entendit réclamer
à manger. Il consulta le Père Kleinsorge, et tous
deux décidèrent de retourner en ville, pour aller
chercher du riz stocké dans l'abri de l'Association de
Quartier de M. Tanimoto et dans celui de la mission. Le Père
Cieslik et deux ou trois autres personnes les accompagnèrent.
Tout d'abord, lorsqu'ils se retrouvèrent parmi les rangées
de maisons fauchées, ils ne surent plus où ils étaient ;
le changement était trop brutal, d'une ville qui, le matin
même, bourdonnait de ses deux cent quarante-cinq mille vies
humaines, en un simple tracé de ruines, dans l'après-midi.
L'asphalte des chaussées était encore mou et brûlant,
du fait de l'incendie et le fouler n'était guère
agréable. Ils ne rencontrèrent qu'une seule personne,
une femme, qui leur dit, alors qu'ils passaient : « Mon
mari est sous ce tas de cendres. » A la mission, où
M. Tanimoto se sépara du groupe, le Père Kleinsorge
fut consterné à la vue du bâtiment, complètement
rasé. Dans le jardin, en se dirigeant vers l'abri, il remarqua
une citrouille, qui avait rôti sur des sarments de vigne.
Le Père Cieslik et lui y goûtèrent et trouvèrent
le mets délicieux. Ils s'aperçurent avec surprise
qu'ils avaient faim, et mangèrent un bon morceau de la
citrouille. Ils tirèrent de l'abri plusieurs sacs de riz,
cueillirent plusieurs citrouilles, également cuites, et
retournant le sol, ramassèrent des pommes de terre en robe
des champs, d'allure fort appétissante ; puis ils
se remirent en route. M. Tanimoto les rejoignit peu après.
L'un de ceux qui l'accompagnaient portait quelques ustensiles
de cuisson.
Dans le parc, M. Tanimoto organisa la cuisine en faisant appel
aux jeunes femmes légèrement blessées de
son quartier. Le Père Kleinsorge offrit à la famille
Nakamura un peu de citrouille ; Mme Nakamura et ses enfants
y goûtèrent, mais ne purent garder ce qu'ils avaient
avalé. En tout, il y eut assez de riz pour nourrir une
centaine de personnes environ.
Peu avant la nuit, M. Tanimoto fit la rencontre d'une jeune femme
de vingt ans, Mme Kamai, sa plus proche voisine. Elle était
accroupie sur le sol et tenait dans ses bras le cadavre de sa
fillette, un bébé, morte, de toute évidence,
depuis le début du jour. Mme Kamai se mit debout d'un bond
à la vue de M. Tanimoto et lui dit « Voudriez-vous,
je vous prie, essayer de retrouver mon mari ? »
M. Tanimoto savait que son mari avait été mobilisé
la veille même dans l'armée ; lui-même
et Mme Tanimoto avaient invité chez eux Mme Kamai, l'après-midi
de son départ, pour la distraire. Kamai devait répondre
à l'appel au quartier général régional
de Chugoku - près de l'ancien château, au centre
de la ville - où quelque quatre mille hommes étaient
encasernés. A en juger au nombre considérable de
soldats mutilés qu'il avait vus durant la journée,
M. Tanimoto supposait que les casernes avaient subi de graves
dégâts, du fait de « la chose »,
quelle qu'elle fût, qui avait atteint Hiroshima. Il savait
qu'il aurait beau se donner tout le mal du monde, il n'avait pas
la moindre chance de retrouver le mari de Mme Kamai ; mais
il ne voulut pas la contrarier. « J'essaierai »,
dit-il.
« Il faut que vous le retrouviez, dit-elle ; il
adorait trop notre enfant. Je voudrais qu'il puisse la revoir
encore une fois. »
 Novembre
1945 Photo: Documents restitués par l'armee américaine.
Novembre
1945 Photo: Documents restitués par l'armee américaine.
Le ruines du Premier hôpital militaire de Hiroshima s'étendent
de l'autre côté de route. Au centre se trouvent les
ruines du château de Hiroshima qui abritait le QG impérial
de la Région militaire Chugoku et d'autres installations
militaires.
[...] M. Tanimoto recommença à
pousser sa barque. Celle-ci, avec les prêtres, avançait
lentement, remontant le courant, lorsque les passagers entendirent
de faibles appels au secours. Une voix de femme, notamment :
« Il y a ici des gens qui vont se noyer ! Au secours !
L'eau monte ! » Les cris venaient d'une lagune
et les prêtres de la barque purent voir, à la lueur
se reflétant dans l'eau, des maisons qui brûlaient
encore, un certain nombre de blessés gisant au bord de
la rivière et que recouvrait déjà en partie
la marée montante. M. Tanimoto voulait aller à leur
aide, mais les prêtres craignirent que le Père Schiffer
ne succombât si l'on ne se pressait et ils insistèrent
pour que leur passeur continuât. M. Tanimoto les débarqua
au même endroit où il avait laissé le Père
Schiffer et repartit seul en direction de la lagune.
La nuit était très chaude, paraissait même
plus chaude du fait des lueurs d'incendie qui rougeoyaient dans
le ciel ; mais la plus jeune des deux fillettes que M. Tanimoto
et les prêtres avaient sauvées, se plaignit au Père
Kleinsorge d'avoir froid. Il ôta sa tunique et l'en couvrit.
L'enfant et sa soeur aînée étaient restées
deux heures dans l'eau salée avant qu'on vînt les
en tirer. Le corps de la cadette portait d'énorme brûlures
à vif ; l'eau salée de la rivière avait
dû être un terrible supplice pour elle. Elle se prit
à trembler de tous ses membres et répéta
qu'elle avait froid. Le Père Kleinsorge emprunta une couverture
à un voisin et l'en enveloppa ; mais elle frissonnait
et tremblait de plus en plus, répétant : « J'ai
tellement froid », et puis, soudain, elle cessa de
trembler, morte.
Sur la lagune, M. Tanimoto trouva quelque vingt hommes et femmes.
Il rangea le bateau le long de la rive et leur dit de se dépêcher
de monter. Ils ne bougèrent pas et il se rendit compte
qu'ils étaient trop faibles pour se soulever. Il se pencha
et prit une femme par les mains ; la peau céda et vint
sous ses doigts, par lambeaux énormes, comme un gant. Cette
sensation éveilla en lui une telle nausée, qu'il,
dut s'asseoir une seconde. Après quoi il sauta dans l'eau
et, de si faible stature qu'il fût, porta jusque dans la
barque plusieurs hommes et femmes, qui étaient nus. Dos
et poitrines étaient visqueux sous la main et il se souvint
non sans malaise des grandes brûlures qu'il avait vues durant
la journée : jaunes d'abord, puis rouges et gonflées,
la peau s'en allant en lanières ; et pour finir, sur le
soir, suppurantes et répandant une infection. Du fait
de la marée montante, son bambou était trop court
maintenant, et il lui fallut pagayer presque d'un bout à
l'autre du trajet. Sur l'autre rive, près d'une lagune
plus haute, il souleva à nouveau les corps, escaladant
avec eux la pente pour les mettre à l'abri de la marée.
Il devait se répéter lucidement et continuellement :
« Ce sont des êtres humains ». Il
dut faire trois voyages avant de les avoir tous transportés
sur l'autre rive. Quand il eut fini, il décida qu'il lui
fallait absolument se reposer et il revint vers le parc.
Alors qu'il gravissait la berge noire, il marcha sur quelqu'un,
trébucha, pendant que quelqu'un d'autre disait d'une voix
irritée : « Attention ! Vous me marchez
sur la main ». M. Tanimoto, tout honteux de faire mal
à un blessé, confus d'être valide, se souvint
soudain du navire-hôpital qui n'était pas arrivé
(et ne devait jamais se montrer), et il fut pris un instant d'une
rage aveugle et meurtrière à l'adresse de l'équipage
de ce navire, puis des docteurs en général. Pourquoi
ne venaient-ils pas au secours de tous ces gens ?
 Le
10 août, à l'hôpital de la Croix-Rouge de Hiroshima,
photo: MIYATAKE Hajime. Les terribles brûlures sur le visage
et les bras montrent que ce garçon se trouvait face à
l'éclair. Le 6 août, sur les cent cinquante médecins
que comptait la cité, soixante cinq étaient déjà
morts et presque tous les autres blessés. Sur mille sept
cent quatre vingts infirmières, mille six cent cinquante
quatre étaient mortes ou trop durement touchées
pour s'employer activement. Au plus grand hôpital de la
ville, celui de la Croix-rouge, six docteurs seulement, sur trente,
pouvaient assumer leur fonction et dix infirmières, sur
plus de deux cents.
Le
10 août, à l'hôpital de la Croix-Rouge de Hiroshima,
photo: MIYATAKE Hajime. Les terribles brûlures sur le visage
et les bras montrent que ce garçon se trouvait face à
l'éclair. Le 6 août, sur les cent cinquante médecins
que comptait la cité, soixante cinq étaient déjà
morts et presque tous les autres blessés. Sur mille sept
cent quatre vingts infirmières, mille six cent cinquante
quatre étaient mortes ou trop durement touchées
pour s'employer activement. Au plus grand hôpital de la
ville, celui de la Croix-rouge, six docteurs seulement, sur trente,
pouvaient assumer leur fonction et dix infirmières, sur
plus de deux cents.
[...] M. Tanimoto, après sa longue course
et ses non moins longues heures de travaux de sauvetage,
sommeillait fiévreusement. Lorsqu'il s'éveilla,
aux premières lueurs de l'aube, il regarda en direction
de la rivière et s'aperçut qu'il n'avait pas transporté
assez haut sur la lagune, la veille, les corps putrescents et
trop faibles des blessés. La marée recouvrait l'endroit ;
ils n'avaient pas eu la force de bouger ; ils devaient être
noyés à l'heure qu'il était. Il vit des corps
qui flottaient au fil de l'eau.
[...] M. Tanimoto en voulait toujours furieusement aux médecins.
Il décida que rien ne l'empêcherait, personnellement,
d'en ramener un au parc Asano, par la peau du cou, s'il le fallait.
Il traversa la rivière, passa devant le temple shintoïste
où il s'était rencontré un bref instant avec
sa femme, la veille, et poussa jusqu'au Champ de Manoeuvre de
l'Est.
L'endroit était désigné depuis longtemps
comme zone d'évacuation ; il avait donc toute chance,
se disait-il, d'y trouver une ambulance.
Il en trouva une, effectivement, où opérait un groupe
médical de l'armée, mais eut tôt fait de s'apercevoir
aussi que les médecins de ce groupe étaient désespérément
surchargés de travail : par milliers les patients
gisaient, sur le champ de manoeuvre, devant l'ambulance, mêlés
aux cadavres. Il n'en alla pas moins droit à l'un des majors
et lui dit, sur le ton de reproche le plus sévère
qu'il put : « Comment se fait-il qu'aucun de vous
ne soit venu au parc Asano ? On a pourtant terriblement besoin
de vous là-bas. »
Sans même lever la tête, sans s'interrompre dans son
travail, le major répondit d'une voix exténuée :
- Mon poste est ici.
- Mais il y a des tas de gens qui se meurent sur l'autre rive.
- Notre premier devoir, rétorqua le major, est de prendre
soin des blessés légers.
- Pourquoi, quand il est tant de blessés graves au bord
de la rivière ? »
Le major passa à un autre patient.
- Dans une catastrophe comme celle-ci, dit-il, et il semblait
réciter la théorie, la première tâche
est de secourir le plus grand nombre possible de gens, de sauver
autant de vies que possible. Il n'y a aucun espoir de sauver les
blessés graves. Ils sont condamnés. Nous n'avons
que faire d'eux.
- Vous avez peut-être raison du point de vue médical... »
commença M. Tanimoto, puis reportant son regard sur le
champ de manoeuvre où tant de morts gisaient, intimement
mêlés et enchevêtrés à ceux qui
respiraient encore, il se détourna sans achever sa phrase,
furieux contre lui-même à présent. Il ne savait
que faire. Il avait promis à certains des agonisants, dans
le parc, de revenir avec un médecin ; ces gens, peut-être,
mourraient avec le sentiment d'avoir été frustrés.
Apercevant une cantine improvisée, à un bout du
champ, il y alla, réclama des gâteaux de riz et des
biscuits qu'il ramena, au lieu de médecins, aux gens du
parc.
Voir la suite d'articles de John Hersey:
J'ai vécu avec les "atomisés" publiés dans France-Soir en 1946 :
- 10 septembre
1946 (Jpg)
- 11 septembre
1946 (Jpg)
- 12 septembre
1946 (Jpg)
- 13 septembre
1946 (Jpg)
- 14 septembre
1946 (Jpg)
- 15 septembre
1946 (Jpg)
- 17 septembre
1946 (Jpg)
- 18 septembre
1946 (Jpg)
- 19 septembre
1946 (Jpg)
- 20 septembre
1946 (Jpg)
- 21 septembre
1946 (Jpg)
- 24 septembre
1946 (Jpg)
- 25 septembre
1946 (Jpg)
- 26 septembre
1946 (Jpg)
- 27 septembre
1946 (Jpg)
- 28 septembre
1946 (Jpg)